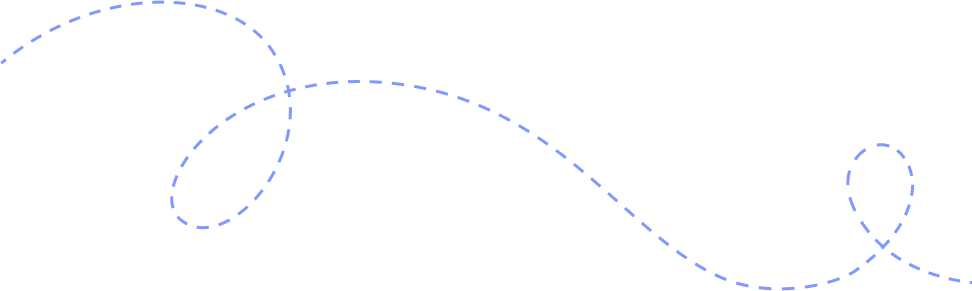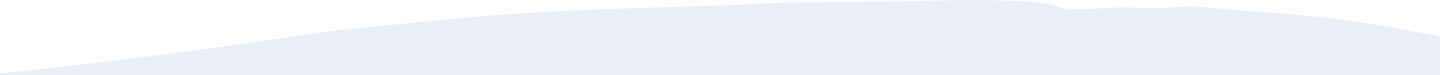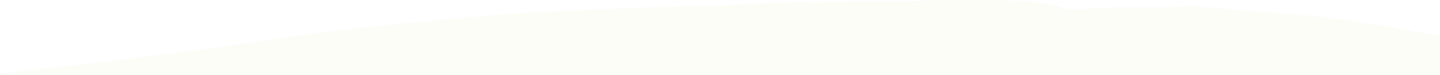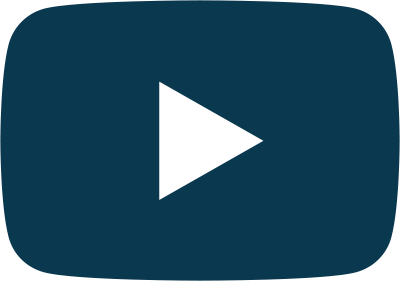Les fêtes de fin d’année peuvent être une période complexe quand on vit avec un trouble psychique. Chez Plein Espoir, on le sait bien : en discutant en conférence de rédaction entre personnes concernées, on s’est rendu compte qu’on avait chacun nos propres difficultés, mais aussi pas mal de solutions qui rendent les choses plus faciles. Contrairement aux idées reçues, cette période ne provoque pas de pic de suicides, mais elle peut amplifier certaines fragilités. Alors pour mieux la traverser ensemble, on a voulu démêler le vrai du faux, et surtout partager des pistes concrètes.
Des solutions existent, et on peut les activer dès maintenant
Avant même de parler des difficultés, parlons de ce qui aide. Parce que oui, cette période peut être compliquée, mais elle peut aussi devenir une opportunité de solidarité collective. « Au lieu de se demander si c’est une période très difficile, que chacun se dise : « C’est peut-être le moment de faire preuve de solidarité ! » », propose Nicolas Franck, psychiatre chef de pôle au Vinatier et coordonnateur du DES de psychiatrie à l’université Lyon 1.
Et concrètement, ça ressemble à quoi ? Chez Plein Espoir, on a justement mis en place plusieurs initiatives ce mois-ci :
- Notre kit pratique pour traverser les fêtes, avec des outils pensés par et pour les personnes concernées
- Le récit d’un réveillon solidaire, parce que personne ne devrait être seul si ça ne lui convient pas
- Notre article sur les amitiés thérapeutiques, pour rappeler qu’on peut construire du lien autrement
Au-delà de nos propositions, des alternatives existent partout sur le territoire : les Groupes d’entraide mutuelle (GEM), les associations, les structures municipales et médico-sociales peuvent proposer de célébrer les fêtes autrement, surtout si les liens familiaux sont distendus ou toxiques.
Ce qu’on croit (à tort) sur les fêtes et le suicide
« La période des fêtes est une période joyeuse de regroupement collectif, qui peut par contraste, accentuer chez certains un sentiment de solitude », explique Nicolas Franck. Contrairement à une idée reçue tenace, elle ne génère pas de pic de suicides : les chiffres montrent même que décembre présente le taux le plus bas de l’année. En France, ce sont plutôt avril-mai les périodes qui semblent les plus à risque.
Pourquoi ce mythe persiste-t-il alors ? Les médias y contribuent : en 2022-23, 40% des articles de presse soutenaient encore cette idée fausse, ce qui peut renforcer la détresse des personnes vulnérables. Gérald Kierzek, médecin urgentiste à l’Hôtel-Dieu de Paris, apporte toutefois une nuance importante au micro de France Inter : « Il y a moins de suicides à cette période-là, mais il y a plus de passages aux urgences car on a une augmentation des idées suicidaires et plus d’appels sur les lignes d’écoute ». Ce qui révèle un paradoxe : si les fêtes n’entraînent pas davantage de passages à l’acte, elles peuvent bel et bien amplifier la souffrance psychique.
Des difficultés différentes pour chacun
Les fêtes de fin d’année surviennent aussi dans un contexte de vulnérabilité biologique propre à l’hiver. « La baisse de luminosité peut accentuer des symptômes dépressifs. Et c’est bien la luminosité qui joue, pas la température », explique également Lucie Joly, psychiatre aux hôpitaux Saint-Antoine à Paris. Le trouble affectif saisonnier (ou dépression saisonnière) toucherait entre 1 et 3% de la population dans les régions tempérées comme la France. À distinguer du « Christmas blues » (le blues de Noël) et du « winter blues » (le blues hivernal) qui sont des formes moins intenses, qu’on ne considère pas comme des troubles à part entière.
Au-delà des facteurs biologiques, les fêtes peuvent charrier un poids psychologique considérable. « Il y a cette pression à être heureux, cette idée qu’on devrait être content d’être avec ses proches. Or ça peut réactiver des traumas ou des conflits familiaux anciens », souligne Lucie Joly, qui mentionne aussi la désorganisation des rythmes de sommeil et de l’alimentation qui ne sont pas sans conséquences quand on a besoin de respecter une routine. Comme en témoigne Mathieu, qui vit avec un trouble bipolaire : « Les périodes de fête sont une épreuve. Émotionnellement, je suis à côté de mes chaussettes… Du coup, la tristesse et le stress m’envahissent ». Lucie Joly rappelle que pour certaines personnes bipolaires, les symptômes peuvent suivre un rythme saisonnier. Pour eux, continuer à prendre son traitement régulièrement et maintenir les rythmes devient alors crucial.
Le plus important ? Respecter les particularités de chacun. Comme le rappelle Nicolas Franck : « Il est impossible de dresser un portrait-type d’un mal être lié aux fêtes, il est toujours nécessaire de faire une analyse au cas par cas ». Chez Plein Espoir, on le constate tous les jours : certaines personnes souffrent d’isolement et bénéficieraient d’un rapprochement, quand d’autres éprouvent de l’anxiété sociale face aux grands rassemblements. Mais on a tous besoin de lien, insiste le psychiatre.
Pour les aider, il propose un changement de perspective de la part des proches : « Plutôt que d’attendre des gens ce qu’ils ne peuvent pas donner, il serait plus intéressant de voir ce qu’ils sont capables de donner… car c’est ce manque de tolérance qui conduit à des difficultés. » Concrètement, ça veut dire quoi ? Faire preuve de compréhension et de chaleur humaine envers les personnes qui traversent des difficultés et accepter que chacun vive les fêtes à sa manière. Par exemple ne pas exiger qu’une personne reste tout le repas si elle a besoin de partir plus tôt, ou encore ne pas insister pour qu’elle participe à tous les jeux de société si c’est trop pour elle.
Ce qui aide concrètement
Alors comment vivre au mieux cette période ? Les experts partagent plusieurs pistes qui rejoignent d’ailleurs ce qu’on expérimente nous-mêmes chez Plein Espoir.
Pour l’entourage et les soignants : privilégier la conversation directe avec les personnes concernées selon Nicolas Franck : « Le but est de savoir comment la personne se sent, connaître ce qui l’aide habituellement à traverser les moments difficiles, ne pas hésiter à proposer des pistes pour l’accompagner si besoin. » Et si des signaux d’alerte apparaissent (comme une impossibilité de faire face au quotidien ou une souffrance permanente), il ne faut pas hésiter à orienter vers un professionnel.
Pour les personnes vivant avec un trouble psychique : ajuster ses propres attentes. « On peut ressentir des émotions qui peuvent être ambivalentes, on ne peut pas être forcément que dans la joie », rappelle Lucie Joly. Se donner la permission de ne pas être dans l’euphorie attendue constitue déjà un premier pas pour prendre soin de soi.
Sur le plan pratique, plusieurs leviers peuvent aider. « Il faut absolument protéger ses rythmes de sommeil et de repas, c’est très important », insiste Lucie Joly. S’exposer à la lumière naturelle en sortant marcher, s’oxygéner, ou à défaut utiliser une lampe de luminothérapie 20 minutes le matin entre 6h et 9h peut faire une réelle différence.
Concernant l’alcool, la vigilance s’impose. Même s’il peut procurer un soulagement immédiat de l’anxiété, il peut en générer ensuite davantage, et « l’après-alcool est extrêmement compliqué à gérer et ne va pas aider les symptômes dépressifs », précise la psychiatre.
Enfin, point crucial trop souvent négligé : ne pas oublier ses traitements. Avec l’effervescence des préparatifs, il peut devenir plus difficile de maintenir ses habitudes thérapeutiques. Un conseil pratique : quand on prépare la valise et les cadeaux, on prépare aussi les boîtes de médicaments.
Chez Plein Espoir, on est convaincus que tous ces conseils pratiques prennent leur pleine puissance dans la solidarité collective. Et que cette période spéciale peut devenir un temps de chaleur humaine : une assiette de plus pour un voisin isolé, le respect des rythmes de chacun, l’acceptation que chacun vit ces moments différemment… Autant d’occasions concrètes de s’entraider.
Des ressources accessibles
En cas de détresse importante : le 3114 (prévention du suicide, 24h/24 et 7j/7), SOS Amitié au 09 72 39 40 50 ou sur sos-amitie.com.
Pour s’outiller au quotidien : les livrets d’auto-soins et le MOOC santé mentale du Centre Ressource de Réhabilitation Psychosociale.