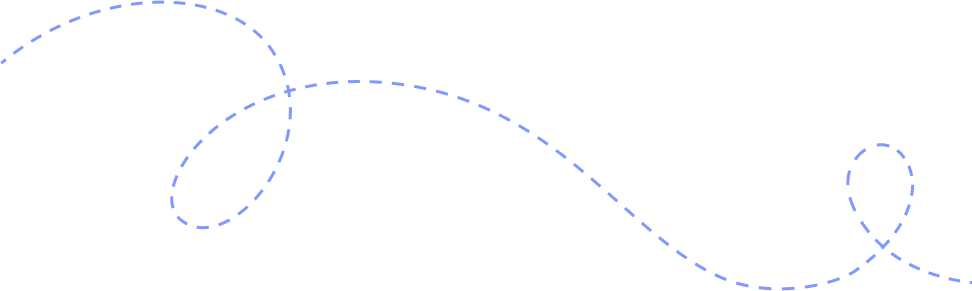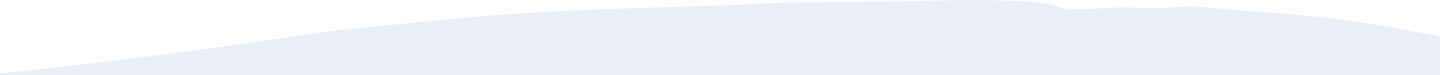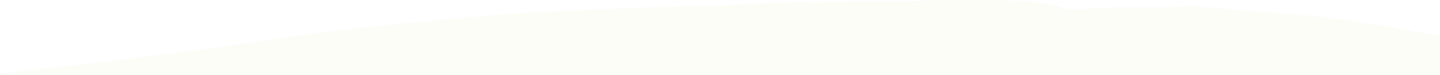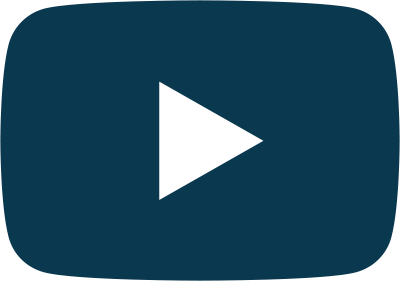Le mot routine est souvent mal perçu. Pourtant, dans les moments de fragilité, elle devient une alliée discrète mais précieuse : elle redonne du rythme, remet du mouvement dans le quotidien et aide à recréer des repères, même quand tout semble difficile. Se lever, manger, dormir à heure fixe… Ce sont des gestes qui peuvent sembler simples, presque anodins. Mais lorsqu’ils sont répétés chaque jour, ils font une vraie différence. Ils deviennent des appuis concrets pour retrouver un peu de stabilité, alléger la charge mentale, et avancer vers le rétablissement.
Pour comprendre toute son importance, Plein Espoir est allé à la rencontre de Virginie Vibulanandan, psychologue clinicienne spécialisée en neuropsychologie, praticienne ICV-LI et en thérapie intégrative (TCC). À travers son travail, elle nous raconte comment les routines peuvent aider à reprendre pied, retrouver de l’autonomie… et parfois même, changer le regard que l’on porte sur soi.
Plein espoir : Les routines sont partout, on en voit dans les vidéos de développement personnel ou chez les sportifs de haut niveau. Mais pourquoi sont-elles si importantes pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques ?
Virginie Vibulanandan : Avant de parler de se dépasser ou de se réaliser grâce à la mise en place de routines, il faut souvent repartir de zéro. Quand une personne qui vit avec un trouble psychique vient me voir, ce n’est pas pour aller mieux tout de suite. C’est d’abord parce qu’elle n’arrive plus à gérer sa vie quotidienne. Elle est trop fatiguée, comme si le corps et l’esprit tournaient à vide. Dans ces moments-là, je commence à dire que ça serait bien de remettre un cadre et donc, une routine. Ce n’est pas un but à atteindre, mais c’est un fil auquel se raccrocher, un moyen de remettre un peu d’ordre là où tout peut sembler impossible.
L’objectif, très souvent, c’est d’aider la personne à sortir de l’isolement. De l’isolement social, bien sûr, mais aussi d’un isolement plus intérieur. Celui qui fait qu’on ne se reconnaît plus, qu’on ne sait plus comment avancer. Alors on commence par des choses toutes simples. Il ne faut pas tout changer d’un coup sinon ça ne marche pas. Les premières étapes, ce sont souvent : se lever, manger et se coucher à heure fixe. On essaie de s’y tenir, chaque jour, même si ça paraît inutile au début. À force de répéter, ça devient plus facile. Et ça soulage.
Plein Espoir : Vous avez un exemple d’une personne que vous accompagnez pour qui la routine a été un vrai soutien ?
Virginie Vibulanandan : Je pense à une patiente qui vit avec un trouble du comportement alimentaire depuis l’adolescence, avec des traumatismes anciens. Elle a un peu plus de cinquante ans aujourd’hui, et depuis un an et demi, elle n’arrive plus à travailler. Dans ces troubles-là, les routines autour de l’alimentation prennent beaucoup de place. Ma patiente mangeait très peu, parfois pas du tout, et buvait de l’alcool pour tenir, pour compenser. Elle venait encore aux rendez-vous et faisait comme si tout allait bien, mais je voyais qu’à l’intérieur, elle s’effondrait.
Il y a un an, on a commencé à parler de son histoire, de ses blessures. Ça l’a fragilisée. Elle a commencé à avoir des troubles du sommeil, des idées noires et elle a encore réduit ce qu’elle mangeait. Parfois, elle ne mange qu’une barre protéinée de la journée. Parce qu’elle ne pouvait pas faire autrement. Dans ces moments-là, le professionnel ne peut pas imposer un cadre. On doit tendre la main. Juste pour l’aider à tenir et lui dire que demain ça ira peut être mieux. Une nuit, elle a chuté et s’est ouvert le crâne. Après son hospitalisation, je lui ai proposé de noter, jour après jour, ce qu’elle faisait, de 8 h à 23 h. À quelle heure elle se levait, se lavait, mangeait, sortait… Au bout de quelques mois, certains créneaux restaient vides. Alors on s’est demandé : à la place de la télé, est-ce qu’elle ne pourrait pas, parfois, appeler une amie ? Glisser, petit à petit, des choses un peu plus positives dans son quotidien.
Plein Espoir : Est-ce que les effets positifs arrivent rapidement ?
Virginie Vibulanandan : Ce n’est pas immédiat, ce n’est pas magique. Mais oui, c’est souvent assez efficace. Beaucoup de patients me disent que le fait d’avoir un cadre les apaise. Ça leur donne un repère, quelque chose de stable dans la journée. Une action simple qu’ils savent pourront accomplir, même quand tout le reste semble compliqué. Et ça compte énormément.
Parce que, petit à petit, le cerveau intègre ces gestes. Ils deviennent automatiques, comme un mode « pilote automatique ». On n’a plus besoin d’y penser. Et ça, ça allège. Ça enlève une part de charge mentale. L’idée, ce n’est pas de tout changer d’un coup, mais de commencer avec ce qu’on peut faire. Même si c’est peu. Et à mesure qu’on avance, ça libère de l’espace dans la tête, dans la journée pour pouvoir ajouter autre chose.
Plein Espoir : Mais en tant que thérapeute, vous ne pouvez pas simplement décider à la place de la personne des routines à mettre en place. Ce n’est pas quelque chose qui doit venir d’elle, avant tout ?
Virginie Vibulanandan : Je dirais que c’est plutôt quelque chose qu’on construit ensemble. Je pars toujours de ce que la personne me raconte : ce qu’elle fait, ce qui lui coûte dans sa journée. Et aussi, de tous les imprévus auxquels elle doit faire face. Il suffit parfois d’une dispute, d’un appel un peu difficile, d’une mauvaise nouvelle… pour que tout ce qu’on avait mis en place disparaisse.
Il y a des hauts et des bas, des moments de découragement, des oublis, des jours sans motivation. Mais l’idée, c’est de stabiliser doucement ce qui peut l’être, sans jamais dramatiser les écarts. Et surtout, de la rassurer. De lui rappeler que ce que la personne fait, c’est déjà beaucoup, que chaque petit pas compte. L’encouragement, c’est aussi une forme de soin.
Plein Espoir : Finalement, ce que vous expliquez, c’est qu’avec les routines, les personnes reprennent peu à peu le contrôle sur leur quotidien. Est-ce qu’on peut dire que ça participe à l’empowerment ?
Virginie Vibulanandan : Oui, ça y participe. Après l’idée, ce n’est pas de tout valoriser à l’excès. Ce n’est pas de dire « bravo » à chaque petite action comme on féliciterait un enfant pour un dessin. Ce qui compte, c’est d’aider la personne à prendre conscience de ce qu’elle fait déjà, même si c’est peu. De reconnaître que ce n’est pas rien. Et surtout, de le faire sans masque, sans illusion : on sait que ce ne sera pas toujours simple, qu’il y aura des rechutes, des jours plus durs. Mais on avance. Ensemble.
Ce sentiment de ne pas être seule, c’est fondamental. Même quand je ne suis pas physiquement là, le fait de savoir que les rendez-vous existent, que quelqu’un suit, écoute, accueille ce qu’elle traverse, ça fait une vraie différence. Parfois, c’est juste ça qui tient : savoir que dans quelques jours, elle pourra dire ce qu’elle a sur le cœur, se déposer un peu. Et repartir.
Plein Espoir : Est-ce qu’on peut dire que la routine fait partie intégrante de la psychoéducation ? Que c’est un des outils qu’on utilise pour aider les personnes à mieux vivre avec leur trouble psychique ?
Virginie Vibulanandan : Oui, parce que la psychoéducation, c’est aussi prendre conscience de ce qu’on a appris et de ce qu’on a déjà construit, malgré les fragilités. Beaucoup de personnes ne se rendent pas compte qu’elles ont développé des ressources, qu’elles ont avancé. Le trouble psychique, avec les biais de pensée qu’il peut entraîner, vient souvent brouiller cette perception. Tout paraît plus négatif, plus flou. L’idée, c’est justement de les aider à voir les choses autrement, à recadrer certaines pensées, à retrouver confiance dans ce qu’elles savent déjà faire.
Dans ce travail, les routines ont toute leur place. Mais ce n’est pas juste “faire tous les jours la même chose”. C’est aussi garder une trace, un repère. Dans l’approche qu’on utilise, souvent issue des TCC (thérapies comportementales et cognitives), on propose des outils concrets : un agenda, un tableau, une sorte de journal de bord. Ça permet de prendre du recul, de se souvenir des choses positives, même quand le mental ne va pas bien. Quand il y a des moments de débordement, de confusion ou de dissociation, ces repères écrits deviennent des points d’appui. Et les séances permettent de relire tout ça ensemble et de remettre du sens.
Ce qui est parfois difficile, en tant que thérapeute, c’est qu’au moment où les choses commencent à aller mieux, certaines personnes pensent qu’elles n’ont plus besoin de rien. Elles arrêtent leur traitement, abandonnent les routines, comme si tout était derrière elles. Alors que, justement, si elles vont mieux, c’est parce que tout ce qu’on a mis en place tient. Ce sont ces repères, ce cadre, ce travail régulier qui leur a permis de retrouver un équilibre. Donc, elles arrêtent tout et on doit reprendre tout depuis le début.
Plein Espoir : Si je comprends bien, les routines permettent de remettre un peu d’ordre, de mouvement, dans le quotidien. Mais d’après ce que vous nous dites, ce qui permet vraiment d’avancer vers le rétablissement, c’est d’abord l’acceptation du trouble.
Virginie Vibulanandan : Oui, c’est ça. Une fois que la personne accepte son trouble, on peut commencer à poser des choses durables, qui vont vraiment l’aider à aller mieux sur le long terme.
Je travaille dans un dispositif qui accompagne des jeunes après un premier épisode psychotique. Ils sont au tout début du trouble. Ce qu’on leur explique, notamment pendant les séances de psychoéducation, c’est que ce n’est pas une fatalité. Statistiquement, un tiers va se rétablir complètement, un tiers fera une rechute mais pourra rebondir, et un tiers connaîtra des rechutes répétées qui peuvent conduire à une forme de chronicisation. Le message, c’est qu’il y a bien des leviers qui existent. Si on met en place un cadre dès le début, un traitement bien suivi, une routine stable, des repères dans le quotidien, alors on peut éviter les rechutes. Certains n’ont même plus besoin de traitement au bout de deux ans. L’enjeu, c’est de leur montrer que c’est possible. Le trouble existe, mais il n’empêche pas de reprendre sa vie en main.
Plein Espoir : Est-ce que c’est un mot routine difficile à faire accepter ? Parce que dans notre société, il a souvent une image négative. Ça renvoie à quelque chose de répétitif, de contraint, qu’on subit plus qu’on ne choisit.
Virginie Vibulanandan : Oui, c’est vrai que le mot peut faire peur. Alors, souvent, je commence par rappeler quelque chose de très simple : dans une journée, on se lève, on mange, on dort. Rien que ça, déjà, c’est une routine. Et ce n’est pas négatif. C’est ce qui permet au corps et à l’esprit de tenir un minimum de rythme.
Il y a aussi d’autres habitudes qui sont parfois mal vues. Par exemple, les siestes. Beaucoup de patients me disent que ça ne sert à rien, ou que c’est pour les personnes âgées. Pourtant, pour quelqu’un qui souffre de troubles du sommeil ou qui est épuisé, une sieste peut vraiment faire la différence. Alors j’essaie de leur expliquer autrement. Je prends souvent l’image du téléphone. Je leur dis : « Votre cerveau, c’est comme une batterie. Si vous ne dormez pas assez la nuit, c’est comme si vous ne rechargiez pas votre téléphone. Le lendemain, il bugue, il ralentit, il s’éteint. Votre cerveau, c’est pareil. Il a besoin de pauses pour fonctionner. »
Quand les personnes comprennent que ces gestes très simples comme se lever à la même heure, faire une sieste, organiser un peu leur journée… les aident à faire des choses qu’elles pensaient impossibles, tout change. Elles reprennent confiance. Petit à petit, le mot “routine” perd son côté négatif. Il ne fait plus peur. Parce qu’elles voient que ça les aide vraiment à avancer, à se sentir mieux. Alors oui, la routine, c’est important pour tout le monde. Mais quand on vit avec un trouble psychique, ça devient un vrai point d’appui. Ce n’est pas une contrainte, c’est une aide. Un moyen de reprendre un peu de contrôle, sans se faire violence. Et d’avancer doucement, jour après jour.