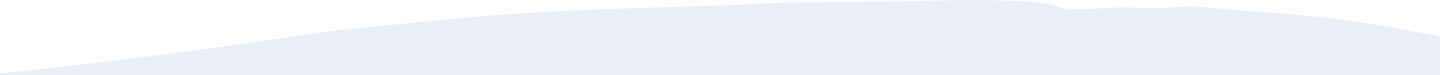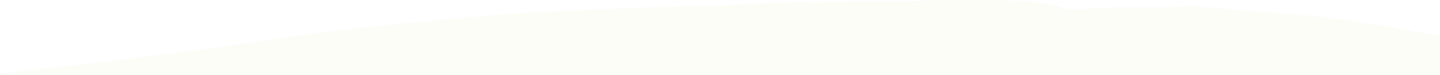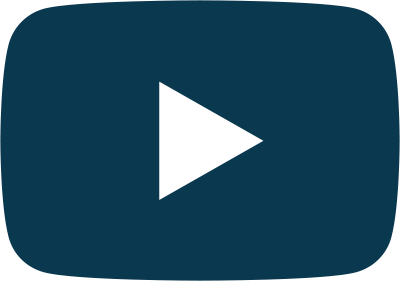Être soignant(e) et vivre avec un trouble psychique
Infirmière en Pratiques Avancées (IPA) en psychiatrie et coordinatrice du comité des usagers, Cécile Glaser a consacré de nombreuses années à soigner et accompagner les personnes concernées par un trouble psychique. Mais un jour, elle a été confrontée à sa propre fragilité : un trouble bipolaire. Ce bouleversement n’a pas seulement modifié son parcours personnel, il a aussi transformé sa vision de la psychiatrie, l’incitant à repenser son rôle et ses engagements.
Dans ce témoignage accordé à Plein Espoir, elle parle de sa double identité : soignante et personne concernée. Elle explique comment cette transition a changé sa façon d’aborder le soin et comment elle parvient à vivre pleinement ces deux rôles. Son parcours, fait de remises en question, d’ajustements, de courage, lui a permis de construire une autre forme de résilience. Un chemin singulier, où l’écoute, le respect et l’accompagnement personnalisé ouvrent la voie du rétablissement. Un chemin où les fragilités ne sont plus des obstacles, mais des repères.
D’abord — et je crois que c’est important de commencer par là — j’ai choisi la psychiatrie un peu par hasard. Ce que je voulais, c’était travailler avec des adolescents. Le premier poste que j’ai trouvé, c’était à la Fondation Santé des Étudiants de France (FSEF - Adhérent de Santé mentale France). Une structure qui aide des jeunes en souffrance psychique à poursuivre leurs soins et leur scolarité. C’est cette dimension-là qui m’a attirée. Et c’est comme ça que j’ai découvert la psychiatrie… pour ne plus la quitter.
En travaillant avec des adolescents, j’ai compris une chose essentielle : l’importance du repérage précoce et de la prise en charge rapide. Cela m’a poussée à intégrer un réseau de santé. L’objectif ? Mieux repérer, mieux orienter, faciliter l’accès aux soins. À ce moment-là, j’étais encore loin du fonctionnement habituel de la psychiatrie publique, avec ses secteurs et son organisation. En 2010, j’ai rejoint la fonction publique hospitalière. J’y travaille toujours aujourd’hui.
Après — et c’est important de le dire — je n’ai pas exercé pleinement entre 2010 et 2020. J’ai basculé du rôle de soignante à celui de personne concernée. Mon trouble bipolaire de type 2 a été diagnostiqué tardivement. Jusqu’alors, mes épisodes dépressifs, bien que fréquents, semblaient isolés. Mais ils se sont intensifiés. Notamment après chacune de mes deux grossesses, en postpartum. Ma première grande crise est survenue à 40 ans.
« Être soignante a sans doute retardé mon propre diagnostic »
Avec du recul, je crois que j’avais des œillères. Travailler en psychiatrie n’a sans doute pas aidé. Je pense même que ça a retardé mon diagnostic. J’avais besoin de garder une distance. De ne pas trop m’identifier aux patients. Je ne me sentais pas légitime pour reconnaître ma propre souffrance, au regard de celle des personnes que j’accompagnais. Dans ma posture de soignante, il y avait cette idée — presque inconsciente — que je n’avais pas le droit de faillir. Je devais rester là, pour eux.
Quand, à mon tour, j’ai eu besoin d’aide, ça n’a pas été simple. Pour mes pairs, accompagner une collègue était délicat. Il y avait de la bienveillance, oui. Mais aussi une forme de gêne. Un tabou difficile à nommer : celui des frontières invisibles entre soignants et soignés. J’ai eu du mal à accepter ma condition de personne concernée. À chaque fin de crise, je croyais que c’était fini. Je faisais comme si rien ne s’était passé. Comme si ça n’avait jamais existé. Il a fallu une nouvelle rechute, plus sévère, qui a conduit à plusieurs mois d'hospitalisation sous contrainte, pour que j’accepte, d’avoir besoin de soins, sur la durée. C’est à ce moment-là que j’ai commencé à comprendre ce que voulait dire, concrètement, le rétablissement.
À l’époque, le mot "rétablissement" n’avait pas le même sens qu’aujourd’hui. Même dans le milieu professionnel. Au début des années 2010, c’était une notion encore très nouvelle. Ce que cela impliquait — accepter sa condition, comprendre qu’une rechute ne remet pas tout en cause, reconnaître qu’au-delà du diagnostic, il y a une vie à construire — restait flou. En psychiatrie, on regarde souvent les choses à travers le prisme d’un symptôme, d’un trouble. C’est ce regard-là que j’ai dû apprendre à faire bouger. Peu à peu.

« Je n’étais plus légitime à exercer en psychiatrie »
Ça a bien sûr eu un impact sur la façon dont je percevais mon travail. Au départ, j'ai pensé que je n’étais plus légitime à exercer en psychiatrie. Que le fait de souffrir moi-même d’un trouble m’enlevait la capacité d’accompagner d’autres personnes en difficulté. C’était une forme d'auto-stigmatisation, renforcée par le fait qu’à cette époque, la question de mon propre rétablissement me semblait encore très lointaine. Il a fallu attendre 2018, que mon état se stabilise, pour que je réalise qu’il existait mille manières d’être infirmière en psychiatrie. Et que, peut-être, je pouvais en inventer une qui me ressemble.
Chez mes collègues, c’était un peu pareil. Il y avait de la bienveillance, mais aussi une forme de crainte. Le fait que je travaille de nouveau dans ce secteur leur semblait risqué, surtout pour moi. Eh oui, ça se savait. Le monde de la psychiatrie, à Paris, est petit. Un jour, je croise un psychiatre que je connaissais, qui savait ce que j’avais traversé. Il m’a demandé si je voulais retravailler. Je lui ai répondu que j’en avais envie, mais que je ne savais pas encore comment. Ni sous quelle forme.
Il m'a expliqué qu'il était devenu chef de service, qu’il allait développer une équipe dédiée aux jeunes adultes, et m’a proposé de le rejoindre. Sur le moment, j’ai accepté, sans trop y croire. Il m’a proposé qu’on prenne le temps d’en reparler. Lors du rendez-vous, il est venu accompagné d’un autre professionnel de santé. Il ne m’a pas parlé de mon trouble, mais il a parlé de mes compétences, de mon expérience, de ce qu'il connaissait de mon travail. Ça m’a profondément touchée. Ça m’a rappelé que mes compétences étaient toujours là, intactes.
C’est comme si quelque chose s’était rallumé en moi. Comme si un chemin redevenait possible. J’ai repris le travail dans son service. Ce qui m’a rassurée, c’est que je n’avais pas besoin de tout expliquer : ma hiérarchie savait, et veillait discrètement à ma reprise. Quant aux collègues et aux patients, je ne me suis jamais cachée. J’avais déjà témoigné publiquement et même participé à un livre sur le rétablissement. Il suffisait de chercher mon nom pour savoir. Je n’en parlais pas spontanément, mais si la question venait, je répondais, simplement.
« Passer de soignant à personne concernée change la posture et l’attention portée aux personnes suivies »
On me pose souvent la question : qu’est-ce que cette expérience de personne concernée m’a apporté dans mon travail ? Je n'aime pas tellement le mot "apporter", comme s’il s'agissait d’un supplément. Forcément, ça change des choses. La posture et l’attention qu’on porte aux personnes qu’on accompagne ne sont plus les mêmes. Deux sujets, en particulier, ont pris une autre dimension. D’abord la parentalité. Parce que moi aussi, je suis maman. Et c’est un sujet dont on parle très peu en psychiatrie : reconnaître que les personnes suivies peuvent aussi être des parents. Prendre en compte leur rôle, ne pas considérer qu’une maladie psychique annule leur vie de parent, ne pas tenir leurs enfants à distance ou faire comme s’ils n’existaient pas.
Le deuxième sujet, pour moi, c’est la sortie d’hospitalisation. Parce que rentrer chez soi, c’est souvent retrouver son appartement comme on l’avait laissé, au plus fort de la crise. On n’y pense pas toujours : quand une personne sort de psychiatrie, on considère qu’elle va mieux, que les symptômes se sont apaisés, et qu’elle peut rentrer chez elle. Mais on ne regarde pas dans quelles conditions elle retourne vivre. Où elle va, dans quel état est son logement, si elle sera entourée. Sur ces questions, mon expérience m’a rendue particulièrement attentive. Et, bien sûr, sur la question des hospitalisations sans consentement, je suis devenue une fervente défenseuse des directives anticipées en psychiatrie. C’est aussi pour mieux intégrer l’entourage, mieux préparer la sortie, prévenir les risques de rechute. C’est essentiel.
Après, sur la question des hospitalisations sous contrainte, il y a des moments où on ne peut pas faire autrement. Mais l’important, c’est de savoir continuer avec. De ne pas rester enfermé dans le traumatisme de l'hospitalisation non consentie. Ce que je constate, et ce que j’essaie aussi de faire avancer dans le service où je travaille, c’est que la voix des usagers n'est pas encore assez entendue au moment de l’hospitalisation. Dans certains établissements, des comités d’usagers se mettent en place. C’est un pas important, mais il reste encore beaucoup à faire pour que cette parole soit pleinement reconnue.
Sur un blog, on avait créé une liste, un peu comme celle qu’on coche avant de partir en voyage. Mais cette fois, c’était la liste des choses essentielles à avoir en psychiatrie, et pourquoi elles comptaient pour nous. Parce que souvent, au moment de la crise, on oublie ce dont on a besoin. Je me souviens que, dans la mienne, j’avais noté : mon oreiller. C’est bête, mais ça change tout. Une amie, elle, avait écrit : un tote bag. Parce que dans beaucoup d’hôpitaux, la douche n’est pas dans la chambre, et il faut transporter ses affaires d’un bout à l’autre du service. Et puis il y avait aussi : penser à appeler cette personne, avoir sa musique préférée, emporter un livre qu’on aime, quelques crayons de couleur. Ce ne sont pas des caprices parce que ces petites choses peuvent vraiment faire la différence.
« L’importance de trouver sa juste place »
Quand j’ai repris le travail, les médiateurs de santé pairs ont joué un rôle essentiel. Je me suis engagée pour qu’ils soient pleinement reconnus dans l’équipe de soins, pour qu’ils participent à part entière à tout ce qui pouvait être proposé aux patients.Travailler avec eux, c’était créer des ponts. Des ponts entre le vécu des patients et l'accompagnement soignant, des ponts aussi entre les différents professionnels.
Récemment, on a créé une association de patients, ainsi qu’un comité des usagers, dans lequel je me suis engagée. Les premières réunions ont été assez troublantes. On parlait beaucoup des droits des usagers, de leur place dans les soins, de la façon dont ils pourraient devenir plus acteurs de leur parcours. Sans le vouloir, ma voix devenait très engagée, comme si j’étais moi-même patiente du service. C’est là que j’ai pris conscience qu’il fallait être attentif à sa posture. Il faut pouvoir se protéger. Parce que, malgré tout, certaines situations peuvent réveiller des échos personnels. Il faut savoir les reconnaître, ne pas se laisser emporter.
Après, ce qui m'a beaucoup aidé, c’est ma formation d’infirmière en pratique avancée. Deux ans d’études supplémentaires, un master, pour élargir mes compétences cliniques, gagner en autonomie, notamment dans l’accompagnement et le suivi des traitements. Depuis l'obtention de mon master, je travaille dans une équipe où je parle ouvertement de mon trouble et de mon parcours. Mon histoire personnelle est connue, respectée, et même intégrée comme une richesse pour l’accompagnement des patients.
« Le travail et le sentiment d’utilité, moteurs de mon rétablissement »
Cela fait désormais cinq ans que je travaille sans arrêt. Rien que ça, c’est un vrai défi relevé pour moi. Au fil du temps, j’ai intégré de plus en plus mon trouble psychique dans mon parcours de vie, dans toutes ses dimensions — personnelle, familiale, professionnelle. Même si chacun a son propre chemin, et que tout le monde ne peut pas ou ne souhaite pas travailler, pour moi, être active a beaucoup compté. Le travail, le sentiment d'utilité que j’en retire, sont devenus des appuis essentiels à mon bien-être.
Cette expérience m’a aussi montré les points à améliorer. En psychiatrie, la notion de rétablissement reste encore à approfondir. Se rétablir, ce n’est pas seulement voir disparaître des symptômes. C’est bien plus vaste : c’est reconnaître toutes les dimensions de la personne, son histoire, ses aspirations, ses valeurs. Pour cela, il faut renoncer à plaquer sur l’autre un modèle tout fait. Être vraiment à l’écoute, rester fidèle à ce qui est important pour la personne elle-même. Aujourd’hui encore, cet aspect me semble souvent malmené.
Et puis, il me tient à cœur de rappeler que, même si la psychiatrie est encore souvent associée à la contrainte et à l’enfermement, nous sommes capables de faire autrement. Accueillir les personnes dans des lieux plus humains, plus ouverts, c’est possible. Mais pour cela, il ne suffit pas de mobiliser les équipes soignantes. Les pouvoirs publics ont aussi leur part de responsabilité. Quels moyens sont-ils prêts à mettre pour transformer l’hôpital ? À mes yeux, c’est fondamental. Car bien souvent, ce n’est pas seulement une question de volonté, c’est d’abord une question de moyens.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.