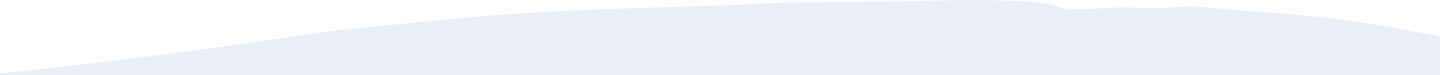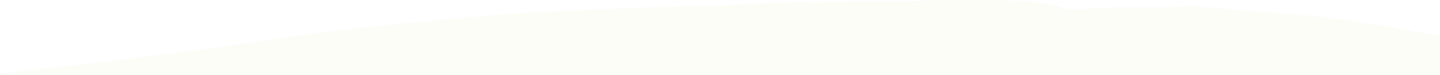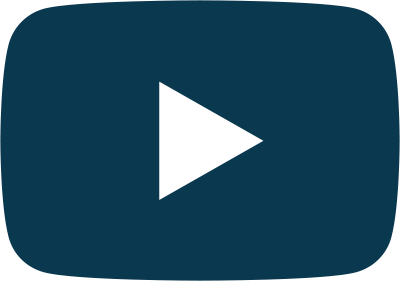Face à l’addiction : « Se sentir moins seule change tout »
Longtemps, Manon, 40 ans, a cru que tout était de sa faute : son incapacité à s’arrêter, les excès, les lendemains au lit. Comme beaucoup d’addicts, elle pensait qu’il suffisait « d’avoir plus de volonté ». Jusqu’au jour où un médecin lui a conseillé de se rendre dans un groupe de parole. Là, en écoutant d’autres raconter les mêmes histoires, elle a compris que le problème n’était pas elle, mais la manière dont l’alcool agissait sur son cerveau. La honte a commencé à reculer. Le regard des autres, les récits qui se répondent, le fait de ne plus être seule… tout cela l’a aidée à aller mieux. Pour Plein Espoir, Manon raconte comment ce groupe a changé sa façon de se voir et a marqué le début de son rétablissement.
Quand on me demande d’où vient mon anxiété, je dis souvent que je suis née stressée. C’est un état que je traîne depuis l’enfance, et qui s’est accentué à l’adolescence, entre les secrets de famille découverts et d’autres violences. Comme beaucoup de jeunes, j’ai voulu tester mes limites, et j’ai eu des mauvaises fréquentations. Les expériences difficiles et les déceptions se sont accumulées. Quand, à trente ans, je me suis séparée de la personne avec qui j’étais en couple depuis huit ans, j’ai explosé.
J’ai toujours eu une consommation d’alcool et d’anxiolytiques assez importante. Au début, c’était mon généraliste qui gérait tout ça et qui me prescrivait de quoi calmer les crises d’angoisses. À cette période, je tournais à quatre Xanax par jour, en plus de l’alcool. Et puis un jour, il m’a dit qu’il ne pouvait plus m’en donner. Là, j’ai commencé à prendre des rendez-vous en urgence sur Doctolib, en visio, juste pour demander de nouvelles pilules. Je n’ai jamais eu de mal à en obtenir. Personne ne m’a jamais demandé quelles étaient mes consommations à côté.
Parler vrai, sans le refuge de l’alcool et des médicaments
Je savais déjà que j’avais un problème. C’est d’ailleurs pour essayer d’arrêter de consommer que j’ai poussé la porte d’une sophrologue il y a dix ans. J’y allais très souvent, mais au fond, ça ne suffisait pas, ça ne changeait rien. Elle m’a orientée vers un nouveau médecin généraliste, qui m’a mise sous antidépresseur et qui m’a envoyée chez un psychiatre addictologue pour ma consommation d’alcool.
Avec lui, on a tout remis à plat. On a commencé un vrai travail. J’ai compris d’où venaient mes problèmes, pourquoi je consommais. C’est là que j’ai réalisé que la consommation n’était qu’un symptôme, pas la cause de mon mal-être. Il m’a conseillé d’aller dans un groupe de parole, dans un CSAPA (Centre de Soin, d'Accompagnement et de Prévention en Addictologie) à côté de chez moi, dans le 18ᵉ. Comme tout le monde, j’avais entendu parler des Alcooliques anonymes ou des Narcotiques anonymes, mais il m’a expliqué que ce sont des groupes où il faut être totalement abstinent, et que pour moi, au début, ce serait trop difficile. Le groupe de parole, c’était surtout pour prendre conscience de mon problème.
Ce qui est très bizarre, c’est que quand on arrive dans ce genre de groupe, on se dit instinctivement que, parmi les gens présents, il y en a avec qui on irait bien boire des coups. C’est ça qui m’a frappée : apprendre à rencontrer des gens, à parler de choses très intimes, en étant complètement sobre. C’est très déstabilisant.
La première fois que j’ai assisté à une séance, je n’étais pas obligée de parler. Comme dans les films, on était tous assis en cercle, sur des chaises, et chacun racontait son problème. Ce n’était pas forcément que l’alcool, il y avait aussi des personnes qui consommaient d’autres substances. L’idée, c’était d’échanger sur pourquoi on consommait, comment, à quel moment. C’était un peu comme un ping-pong, chacun rebondissait sur ce que l’autre disait.
Au fil des séances, je me suis rendu compte que ce que je vivais, d’autres le vivaient aussi. Des gens « normaux », qui bossaient, qui avaient une vie de famille, et qui traversaient exactement les mêmes galères que moi. Ça m’a fait un bien fou. Et surtout, ça m’a permis de comprendre un truc : moi, je ne cherchais pas juste à boire, je cherchais à me perdre.
La force de l’entraide entre personnes concernées
Il faut savoir que quand on est addict, on culpabilise énormément, on a une très mauvaise estime de soi. On fait de l’autostigmatisation parce qu’on fait des choses qui ne sont pas dans les normes et qu’on peut faire du mal aux gens qu’on aime. Dans le groupe, voir des personnes qui avaient une vie « normale », ça m’a vraiment marquée. Il y en avait une, je m’en souviens très bien, une instit. La première fois que je l’ai vue, je ne comprenais pas ce qu’elle faisait là. Je me suis même dit qu’elle venait peut-être pour son fils ou un proche. Et puis j’ai appris son histoire. Elle avait l’habitude de corriger ses copies le soir au troquet, avec un petit verre. Et une fois à la retraite, elle a continué. Sauf que comme elle n’avait plus de copies, elle restait deux, trois, parfois quatre heures au bar. Très souvent, son mari finissait par venir la chercher, parce qu’elle n’était plus capable de se lever et de rentrer seule.
Après mes premières séances, j’avais directement envie d’aller boire. Forcément, pendant une heure, on ne parlait que de consommation. Au début, ça déclenchait plus que ça ne calmait. Mais au fil des semaines, en revoyant toujours les mêmes personnes, il se passait quelque chose. Chaque séance, on racontait ce qui s’était passé depuis la dernière fois : comment on avait consommé, dans quelles situations, comment on s’était senti. Et on apprenait à identifier les situations à risque. On se demandait : qu’est-ce qu’on fait quand ça arrive ? Comment est-ce qu’il faut réagir ? Ce qui m’a beaucoup aidée : comprendre ce qui déclenchait mes envies et comment y faire face. L’animateur donnait quelques conseils en fonction de nos besoins, mais au fond, ce n’était pas forcément lui qui apportait le plus. C’était surtout nous, entre addicts, qui nous aidions. Je me souviens de quelqu’un qui nous avait expliqué qu’il mélangeait de la ginger beer avec du jus de fruit, pour que ce soit plus corsé, et que ça lui donne l’impression de boire de l’alcool.
Mettre des mots à plusieurs sur les mêmes excès
Moi, même si je n’avais pas envie d’arrêter complètement, ma vraie problématique, c’était que je n’arrivais pas à m’arrêter une fois que je commençais. Et derrière, je me mettais dans des situations dangereuses, ou alors le lendemain j’étais tellement mal que je n’arrivais même plus à aller travailler. C’était plus fort que moi. Tous les jours, je me disais : non, ce soir tu ne bois pas. Puis, en rentrant chez moi, je passais devant un bar. Je me disais : allez, juste un verre. Et ça finissait en deux, trois bouteilles. Dans le groupe, il y en avait qui se lançaient des petits challenges, du genre : la prochaine fois que je vais voir mes copains, je bois un jus de fruit. En parlant ensemble, on se rendait compte que même si la personne commençait par un jus, elle finissait quand même par prendre un verre. Une fois qu’elle avait commencé, c’était trop tard, elle ne pouvait plus s’arrêter. C’est comme ça que j’ai compris certaines choses sur moi. Il y a un vrai effet miroir. Ça provoque une grosse prise de conscience. Du coup, j’ai pris la décision de ne plus sortir pendant un moment. Je l’ai compris grâce aux groupes de parole.
Trois ans plus tard, j’ai quitté Paris. Et ça aussi, ça a été un vrai pas dans ma guérison, ou en tout cas dans ma prise de conscience. Je suis partie à Chartres. Là-bas, à 23 heures, tout est fermé. Alors qu’à Paris… j’habitais dans le 18e, et même quand les épiceries fermaient, je pouvais toujours trouver un bar pour boire toute la nuit. C’est plus simple. Quand j’ai déménagé de Paris, l’un de mes premiers soucis, ça a été de me dire : je vais devoir quitter le groupe. J’étais même prête à faire des allers-retours Chartres-Paris tous les jeudis pour continuer les séances. J’ai essayé au début, mais c’était vraiment trop contraignant. Ça montre à quel point les bénéfices étaient importants.
En tout cas, ça me motivait énormément. Comme je le dis souvent, le simple fait de se sentir moins seule, ça évite de lâcher complètement. On se dit : la semaine prochaine, je vais revoir machin et machine, et j’ai envie qu’ils soient contents pour moi, parce que ça fait trois semaines que je n’ai rien consommé. J’ai envie de leur montrer que moi aussi, je suis capable. Il y a un vrai effet de stimulation collective positive et aussi la déculpabilisation personnelle.
L’impact du groupe sur le travail de l’image de soi
Pour parler de déstigmatisation, le fait d’être confrontée à d’autres te fait énormément réfléchir. Tu prends conscience de tout ce qui ne dépend pas entièrement de toi. Tu te dis : j’ai peut-être un terrain familial, une angoisse qui cherche à s’exprimer, qui s’apaise temporairement avec les substances. Et surtout, tu réalises que tu n’es pas responsable de tout. Pour l’image de soi, c’est essentiel.
Avant, je pensais que l’alcool n’avait cet effet que sur moi. Que j’étais la seule à finir dans des états pareils. Mes potes pouvaient boire trop, mais ils n’en arrivaient jamais là où j’allais. Moi, je me suis retrouvée plusieurs fois à l’hôpital : la tête ouverte, une côte cassée… Je me disais que j’étais faible, que je ne tenais pas l’alcool. Alors qu’en réalité, c’est simplement le produit qui réagit différemment dans mon cerveau. Quand tu comprends ça, tout change.
C’est pour ça que les groupes de parole ont tant compté pour moi. On y découvre que ce qu’on vit n’est pas un défaut personnel, mais un mécanisme partagé. Que d’autres traversent exactement les mêmes choses. Ça enlève un poids immense. Et surtout, ça redonne un peu de dignité. Mais c’est un travail lent et fragile. Il faut déconstruire des années de honte, de « c’est de ma faute », de regards qui jugent trop vite. Le rétablissement, ça tient parfois à un fil. Il y a des jours où ça va, et d’autres où tout se remet en question. Des jours où tu entends ta mère dire : « Oh, si tu ne bois pas, ça va être triste. » Ou ton père répéter que le problème, c’est que tu ne sais pas boire.
Pourtant, aujourd’hui, je sais que je suis sur la bonne voie. Ma consommation a changé : elle est consciente, cadrée. C’est fragile, oui, mais j’ai retrouvé ma lucidité, et rien que d’en avoir conscience, c’est déjà une forme de guérison. C’est un vrai pas. Même quand je bois, je me fais une gymnastique mentale pour me dire : attention, n’ouvre pas la deuxième bouteille, tu sais comment ça finit. Et pour l’instant, cette gymnastique tient.