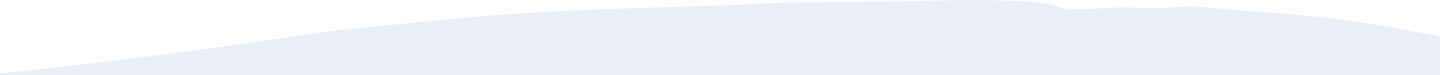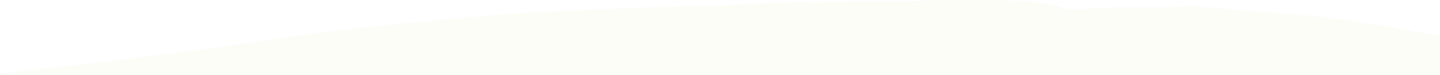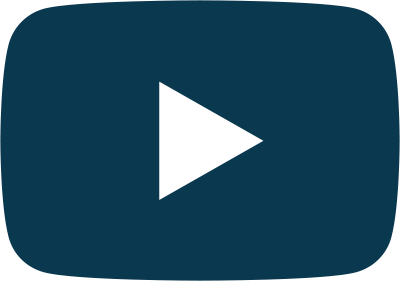Quand les patients prennent la parole : une autre histoire de la psychiatrie
Pendant longtemps, la psychiatrie a parlé sur les patients, mais a rarement dialogué avec eux. Dans cet entretien pour Plein Espoir, l’historienne Aude Fauvel retrace une histoire largement occultée : celle des mobilisations de patients, des savoirs expérientiels (fondés sur l’expérience directe de la maladie) tenus à distance, et des résistances françaises à leur reconnaissance, jusqu’aux signes actuels d’un possible changement.
Plein Espoir : On donne souvent une vision repoussoir de l’histoire de la psychiatrie avec l’asile comme symbole d’une époque révolue, et l’idée qu’aujourd’hui on aurait tourné la page. Est-ce que cette vision est vraie ?
Aude Fauvel : L’histoire de la psychiatrie fait peur un peu partout dans le monde, pas seulement en France, et cela participe à la stigmatisation des personnes concernées mais aussi des établissements et des soignants. Dans la culture populaire, l’asile est souvent un décor d’horreur comme l’asile Arkham (dans l’univers Batman). Côté soignants, il y a des figures de psychiatres tout-puissants, manipulateurs, avec le stéréotype du fameux Docteur Mabuse (un personnage de fiction hypnotiseur, symbole du mal absolu, mis en scène par Fritz Lang), ou Hannibal Lecter. Côté infirmiers, on trouve le personnage tyrannique de l’infirmière dans Vol au-dessus d’un nid de Coucou, ou l’imaginaire du « gros bras ». Et côté patients, l’idée que l’enfermement et la maltraitance les rendait encore plus dangereux, qu’il ne fallait surtout pas qu’ils s'échappent. Un stéréotype toujours présent aujourd’hui, quand un patient s’échappe on entend souvent le terme de forcené (une personne violente et hors de contrôle, ndlr). Mais ce n’est pas seulement fantasmé : une partie de ces représentations s’ancre dans une réalité historique.
Plein Espoir : Pourtant, vous rappelez que le mot asile ne désignait pas au départ l’enfermement, mais un droit. Comment a-t-on basculé vers ce modèle ?
Le mot asile renvoie effectivement, à l’origine, au droit d’asile, donc à l’idée de protection. Dans la première moitié du XIXᵉ siècle, avec la naissance de la médecine aliéniste (la psychiatrie en faveur du développement des asiles, ndlr), on porte un regard relativement optimiste sur les troubles psychiques. Des figures comme Philippe Pinel, présenté comme le « libérateur des fous », affirment que les personnes dites insensées ne sont ni possédées ni incurables, mais malades, et donc potentiellement soignables. Avec Jean-Étienne Esquirol, la loi de 1838 oblige l’État à prendre en charge les « aliénés indigents » dans des établissements dédiés. L’idée est alors de créer de petites structures, pensées comme de véritables « machines à guérir », afin de sortir les patients des hospices et des prisons. Mais ce projet échoue rapidement. Entre 1840 et 1950, les taux d’amélioration (ce que l’on appellerait aujourd’hui le rétablissement) restent très faibles, autour de 5 à 10 %. Dans la majorité des cas, entrer à l’asile signifie y rester. Le nombre de patients explose, les moyens manquent cruellement, et s’installe un pessimisme thérapeutique durable. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, l’asile de Clermont, dans l’Oise, compte plus de 4 400 patients pour quelques médecins seulement. Dans ce contexte, l’idée que les patients sont incurables s’impose, accompagnée de notions violentes du dégénéré qui va transmettre ses tares, qui doit être enfermé, on parle d'héréditaire incurables, de congénitaux, bref des mots qu’on employait avant pour parler de personnes concernées, devenus des insultes aujourd’hui. Les traitements suivent cette logique : après une première confiance dans des remèdes basés sur la psychologie, puis sur le corps, apparaissent les thérapies de choc de l’entre-deux-guerres (électrochocs sans anesthésie, comas thérapeutiques, lobotomies, hydrothérapies, sommeil forcé), réservées à une minorité jugée « récupérable ». Pour les autres, qualifiés de « non-valeurs sociales », l’horizon devient l’enfermement, l’eugénisme, voire la stérilisation.
En France, cela ne prend pas la forme d’une politique d’euthanasie assumée, mais sous Vichy, la mort par famine de milliers de patients psychiatriques ne suscite pas de réaction massive. Cette histoire explique pourquoi, à partir des années 1960, en France comme ailleurs, le mot asile devient indéfendable et pourquoi ce modèle est progressivement remis en cause.
Plein Espoir : Après la Seconde Guerre mondiale, comment s’opère le tournant vers une psychiatrie plus critique de l’asile, et à quel moment la parole des patients commence-t-elle réellement à être entendue ?
À la fin de la Seconde Guerre mondiale, des médecins s’insurgent contre l’état des hôpitaux psychiatriques et contre la violence institutionnelle qu’ils découvrent ou redécouvrent. Émerge alors une nouvelle génération de psychiatres réformateurs comme François Tosquelles, Stanislaw Tomkiewicz ou Jean Oury, souvent marqués par l’exil, la guerre ou les camps. Ils défendent une autre idée de la psychiatrie. Celle d’écouter les patients, travailler avec les infirmiers, ouvrir les institutions et sortir du modèle asilaire.
Dans le même temps, apparaissent des associations de familles, d’usagers, puis de patients, et les témoignages de personnes concernées commencent à circuler davantage, même si en France, cela reste assez discret. Ces évolutions sont rendues possibles par plusieurs facteurs : l’arrivée de nouveaux médicaments, des pratiques innovantes, un contexte économique plus favorable, mais aussi un vaste mouvement critique qualifié d’« antipsychiatrique », qui traverse la culture populaire et le monde universitaire, avec des figures comme Michel Foucault et L’Histoire de la folie en 1961.
Ce qui est souvent oublié, c’est l’ampleur du phénomène. À la veille de la Seconde Guerre mondiale, on compte en France six à huit fois plus de personnes internées en psychiatrie que de détenus en prison. Cela concerne des dizaines de milliers de personnes et représente l’un des principaux postes budgétaires de l’État. Je me suis intéressée à ce champ d’étude car pour moi, il était impossible que ces patients ne tentent pas de s’organiser, de prendre la parole, de produire leurs propres récits. Et c’est bien ce que l’on observe. Dès lors que les médecins écrivent sur les « fous », les patients commencent à écrire sur leurs médecins.
C’est là que se construit l’idée d’un savoir de première main, fondé sur l’expérience vécue, et la revendication d’être consultés. Des récits de rétablissement émergent, parfois capables d’influencer les lois ou les pratiques.
Plein Espoir : Existe-t-il des exemples étrangers où les patients ont été entendus plus tôt qu’en France ?
Aude Fauvel : Oui, très clairement. Dès les années 1840, au Royaume-Uni, des patients parviennent à créer des associations et à se faire entendre. Les femmes jouent un rôle important dans ces mobilisations, notamment autour de la défense des droits des patients et de la critique d’une psychiatrie dominée par des hommes. Ces préoccupations sont progressivement intégrées au système britannique, avec la mise en place de commissions de surveillance des établissements et une attention précoce aux droits des personnes hospitalisées. En France, il faut attendre les années 1990 pour voir apparaître réellement cette logique de droits des patients. Cela ne signifie pas qu’il n’y ait eu aucune tentative auparavant, mais elles sont restées marginales. On retrouve là une spécificité française : un modèle très fondé sur l’expertise, fortement hiérarchisé, où le diplôme reste la principale source de légitimité. Ce n’est d’ailleurs pas propre à la psychiatrie. En France, sans diplôme, il est souvent difficile d’être reconnu comme porteur d’un savoir valable. Cette logique perdure jusque dans des évolutions récentes, comme la création de diplômes pour les médiateurs santé-pairs, qui reproduit en partie ce modèle expert.
Historiquement, la folie est pensée comme incompatible avec la capacité de jugement. Si l’on est considéré comme « fou », on est supposé incapable de dire soi-même que quelque chose ne va pas. Il y a les malades, et il y a les experts. Le partage du dossier médical reste d’ailleurs encore aujourd’hui une question sensible. Enfin, il faut rappeler que cette reconnaissance de la parole des usagers dépasse largement la psychiatrie. Il a fallu des morts, notamment lors de l’épidémie de sida, pour que les patients soient enfin reconnus comme des interlocuteurs légitimes dans le système de santé.
Plein Espoir : Avez-vous des exemples concrets, de personnes ou de mouvements, qui montrent qu’une autre psychiatrie a été possible et parfois durablement ?
Aude Fauvel : Oui, et ils sont très éclairants. En psychiatrie comme ailleurs, chaque pays a longtemps défendu « son » modèle. En France, on a fini par considérer comme allant de soi l’asile, la contrainte, la camisole, les lits à sangles, parce que le pays était dépositaire d’un brevet sur la camisole. Mais ailleurs, d’autres choix ont été faits très tôt.
Au XIXᵉ siècle, les Britanniques, en particulier en Écosse, adoptent le principe du no restraint, c’est-à-dire sans contrainte physique. On y privilégie la discussion, l’inclusion des usagers et la prise en compte de leur avis. Pour cela, ils s’inspirent notamment d’un modèle ancien et toujours vivant : la ville de Gheel en Belgique, longtemps surnommée « la ville des fous ». Depuis le Moyen Âge, on y accueille des personnes ayant des troubles psychiques non pas dans un asile, mais au sein de familles, dans la ville même. Au XIXᵉ siècle, les médecins choisissent d’encadrer ce système plutôt que de le supprimer, car il fonctionne. Les personnes vivent libres, actives, intégrées et ne sont pas plus dangereuses. À son apogée, jusqu’à un tiers de la population est concernée. Ce modèle remet frontalement en cause la psychiatrie experte, car ce sont surtout des non-professionnels (familles et pairs) qui prennent soin, dans une logique d’expertise partagée. Les patients eux-mêmes s’en emparent très tôt : « C’est ça que nous voulons ».
Les Écossais tentent d’en reproduire les principes avec succès. L’hôpital y est pensé comme un simple maillon d’une chaîne de soins, dont le but reste l’insertion. Il valait clairement mieux être hospitalisé en Écosse en 1860 qu’en France en 1950. On y trouve des journaux écrits par les patients, des journées portes ouvertes, des expositions d’art, et même des manuels de co-construction de savoirs psychiatriques entre patients et médecins, chose que nous n’avons toujours pas pleinement réalisée aujourd’hui. Cette tradition a laissé des traces durables. Dans les années 1960-1970, des psychiatres comme Ronald Laing ou David Cooper défendent l’idée de communautés thérapeutiques, non pour abandonner les patients, mais pour éviter ce qu’on appelle la « clochardisation » de patients qui, à force d’hospitalisations répétées, se retrouvent progressivement à la rue ou encore leur incarcération à vie. Ces exemples montrent qu’une psychiatrie fondée sur la liberté, la parole et la reconnaissance des savoirs des personnes concernées n’est ni utopique ni nouvelle, elle a existé, et elle peut encore nous inspirer aujourd’hui.
Plein Espoir : Y a-t-il eu, en France, des pionniers qui ont cherché à libérer la parole des patients en psychiatrie ?
Aude Fauvel : Oui, même si ces initiatives sont longtemps restées minoritaires. Dès la Belle Époque, certains psychiatres tentent d’ouvrir des brèches. Auguste Marie, par exemple, s’inspire des modèles écossais et défend des pratiques qui annoncent ce que l’on appellera plus tard l’art-thérapie. Édouard Toulouse développe quant à lui des centres de consultation ouverts, en dehors de l’internement, convaincu que les personnes peuvent se rendre compte elles-mêmes qu’elles ne vont pas bien. Il est notamment influencé par Clifford Beers, ancien patient devenu une figure majeure de la réforme psychiatrique au début du XXᵉ siècle. Avec son livre A Mind That Found Itself (1908), véritable récit de rétablissement, Beers affirme qu’il faut prendre au sérieux la parole des patients et fonde ce qui deviendra le socle de la notion moderne de santé mentale. Son immense succès public est toutefois suivi d’une mise à l’écart progressive, illustrant un schéma récurrent : des phases d’ouverture, puis des retours en arrière.
A côté de ces figures médicales, émergent aussi des associations d’usagers et de familles, comme l’UNAFAM, qui trouvent un certain écho auprès des psychiatres dits « désaliénistes ». Enfin, le rôle des femmes psychiatres est souvent sous-estimé : des praticiennes comme Constance Pascale, à la tête d’un service à Clermont au début du XXᵉ siècle, ou Agnès Masson, attentive aux dispositifs ambulatoires, se montrent particulièrement sensibles à la parole et à l’expérience des patients. Ces initiatives n’ont pas renversé le modèle dominant, mais elles montrent qu’en France aussi, la contestation de l’asile et la reconnaissance des savoirs des patients ont une histoire discontinue, fragile, mais bien réelle.
Plein Espoir : Aujourd’hui, peut-on dire que la place et la parole des patients ont réellement changé en France ?
Aude Fauvel : Oui, il se passe clairement quelque chose, même si tout reste fragile. Longtemps, les patients ont été très peu intégrés à l’évaluation des politiques de santé mentale et c’est encore largement le cas. Mais depuis une quinzaine d’années, des signes forts apparaissent. La reconnaissance des médiateurs santé-pairs en 2012 marque une entrée officielle du savoir expérientiel dans l’institution. En 2014, la première Mad Pride en France affirme publiquement une parole collective, dans la lignée de celle de Toronto. On voit aussi émerger des collectifs, des podcasts, des blogs, des réseaux d’entraide, et un vocabulaire nouveau : parcours, vécu, rétablissement.
Cette évolution dépasse le champ médical. La culture s’en empare aussi, avec des œuvres co-construites comme le jeu vidéo Hellblade (2014), développé avec des personnes ayant vécu des troubles psychiques, avec des avis partagés sur le rendu. En parallèle, on observe une libération de la parole inédite. Des personnes parlent de leur hospitalisation, malgré une stigmatisation toujours très forte car dire qu’on a été hospitalisé en psychiatrie reste socialement stigmatisant. Mais l’histoire nous met en garde. Ces moments d’ouverture ont déjà existé. Aujourd’hui encore, la reconnaissance de la parole des patients coexiste avec la peur du « fou dangereux » et une psychiatrie en grande souffrance, faute de moyens. La question centrale demeure donc : continue-t-on à penser la psychiatrie en silos, ou accepte-t-on enfin de construire avec les personnes concernées ? Comme le résument les Mad Studies (un domaine d’études consacré aux expériences, cultures et enjeux politiques des personnes vivant avec des troubles psychiques ou neurodivergentes), cette notion de folie doit se faire en co-construction, avec en fond cet adage : « Rien sur nous sans nous. » Nous sommes dans une période de bascule même s’il ne faut rien prendre pour acquis.