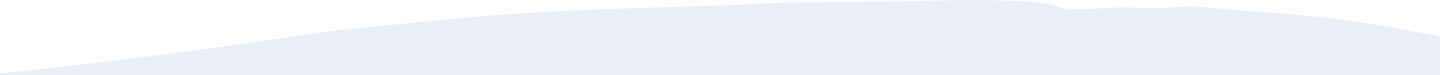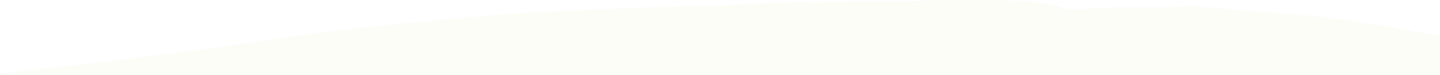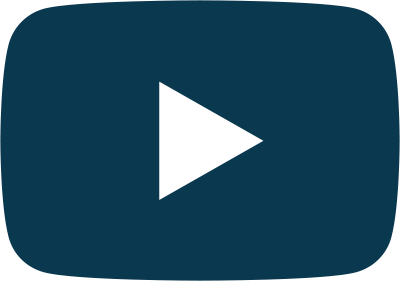Changer de regard pour mieux comprendre : phénoménologie et psychiatrie
Et si une autre façon de penser la maladie mentale pouvait enrichir la relation de soin ? Camille Abettan, psychiatre au CHU de Montpellier et chercheur spécialisé en phénoménologie, nous fait découvrir cette approche philosophique rigoureuse qui propose de repenser notre rapport au temps, à l'espace et à la perception. Sans recette toute faite, elle ouvre de nouvelles perspectives de compréhension qui peuvent nourrir autrement la relation thérapeutique.
Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la phénoménologie ?
La phénoménologie, c'est un courant de la philosophie allemande du début du 20ème siècle, porté par des penseurs comme Husserl et Heidegger. Leur grande question, c'était : comment fait-on l'expérience du monde ? Pas seulement ce qu'on pense du monde, mais comment on le vit concrètement au quotidien. Comment perçoit-on ce qui nous entoure ? Comment vivons-nous le temps qui passe - cette impression que parfois il file à toute vitesse, parfois il s'étire interminablement ? Comment habitons-nous l'espace, un lieu familier où on se sent chez soi versus un endroit où on se sent perdu ?
Ces philosophes ont développé des concepts très précis pour décrire tout cela, et au début du XXème siècle, des psychiatres se sont intéressés à ces travaux. Il faut dire qu’à l'époque, comme aujourd'hui d'ailleurs, la psychiatrie était surtout dominée par des explications biologiques. Le cerveau, les neurotransmetteurs, la génétique... C'est évidemment important et pertinent, mais ces psychiatres trouvaient que ça ne suffisait pas à saisir toute la réalité de ce que vivent leurs patients.
Vous avez travaillé sur les œuvres de Heidegger, Binswanger et Maldiney. Concrètement, qu'est-ce que leurs travaux nous apprennent sur l'expérience de la maladie mentale ?
Heidegger lui-même ne s'est pas vraiment intéressé à la psychiatrie, mais il a profondément renouvelé notre façon de penser le rapport de l'être humain au temps et à l'espace. C'est Binswanger qui a repris ce vocabulaire pour l'appliquer aux troubles psychiatriques.
Par exemple, il a montré que les personnes psychotiques ou maniaques vivent différemment le temps et l'espace. Quand quelqu'un vit un épisode maniaque, son rapport au temps s'accélère, le futur semble à portée de main immédiate. Dans la dépression au contraire, le temps peut sembler figé, interminable. Dans certaines psychoses, l'espace lui-même peut être vécu différemment, de manière fragmentée ou menaçante.
Binswanger a donné des outils conceptuels pour penser ces modifications de l'expérience temporelle et spatiale non pas comme de simples "symptômes", mais comme des façons différentes d'habiter le monde.
Et Maldiney, lui, qu'apporte-t-il ?
Maldiney s'est concentré sur la perception, et c'est vraiment fascinant. Il s'est appuyé sur les théories de la perception chez Husserl et Heidegger pour comprendre comment les personnes psychotiques ont du mal à entrer en communication avec leur environnement.
Il fait une distinction importante : en temps normal, nous percevons des objets bien définis (cette chaise, cet ordinateur), c'est ce qu'on appelle la perception "intentionnelle", dirigée vers quelque chose de précis. Mais il y a aussi tout ce qui se trouve "entre" ces objets, une sorte de fond perceptif auquel on ne prête généralement pas attention et qu'on ne peut pas vraiment nommer parce que ça n'a pas de forme définie. C'est la perception "non-intentionnelle".
Or, Maldiney a montré que dans la psychose, c'est justement ce lien perceptif avec l'environnement qui est modifié. Les personnes psychotiques sont moins réceptives à cette dimension non-intentionnelle de la perception, ce qui complique leur ancrage dans le monde et leur communication avec les autres.
En comprenant cela, on comprend mieux pourquoi une personne psychotique peut sembler "déconnectée" de son environnement : ce n'est pas qu'elle ne veut pas communiquer, c'est que les modalités perceptives qui la relient au monde sont transformées.
Concrètement, dans votre pratique de psychiatre, est-ce que cette approche change quelque chose ?
C'est une question importante, et je vais être honnête : la phénoménologie ne donne pas de "recettes" directement applicables. Ce n'est pas une méthode thérapeutique avec un protocole précis. Ça ne change pas mes prescriptions ni le déroulement formel des consultations.
Mais, et c'est essentiel, cela change profondément ma façon de comprendre ce qu'est la maladie mentale. Et quand on comprend différemment, on ne se comporte pas de la même manière, on ne prend pas les mêmes décisions.
Si je rencontre une personne dépressive, par exemple, et que je garde à l'esprit que son rapport au temps est transformé, que l'avenir lui semble bloqué, inaccessible, ma façon d'être avec elle, mes mots, mon attention seront différents. Je ne me contenterai pas de "traiter des symptômes", j'essaierai de comprendre comment elle habite le monde à ce moment-là.
C'est un impact indirect mais réel sur la relation thérapeutique. L'effet sera différent avec chaque patient, et je ne peux pas le mesurer précisément, mais c'est là : dans la qualité de l'écoute, dans la justesse des mots, dans la compréhension plus fine de ce qui se joue.
Cette approche qui s'intéresse à la façon dont chaque personne vit son expérience permet-elle de mieux reconnaître la singularité de chacun ?
Attention à un malentendu fréquent ! Depuis les années 70-80, et encore aujourd'hui avec le regain d'intérêt pour la phénoménologie, certains la présentent comme une approche "personnalisée" qui s'opposerait à la science "froide" : d'un côté la biologie qui oublierait la personne, de l'autre la phénoménologie qui s'y intéresserait vraiment.
C'est une erreur complète. Les premiers psychiatres phénoménologues comme Binswanger ont toujours insisté : la biologie et la phénoménologie sont complémentaires, pas opposées. Les deux sont nécessaires, et plus on a d'approches différentes, mieux on aide les gens.
D'ailleurs, leur ambition n'était pas de s'éloigner de la rigueur scientifique, au contraire ! Ce qu'ils reprochaient aux approches naturalistes, c'était justement de ne pas être assez scientifiques, d'être réductrices. Ils voulaient une approche encore plus rigoureuse.
Et puis soyons clairs : on ne peut jamais vraiment accéder au vécu intime d'une autre personne. Il n'y a que vous qui éprouvez ce que vous éprouvez. Aucune approche, même la phénoménologie, ne franchit cette limite. Ce qu'elle apporte, c'est une méthode rigoureuse pour penser autrement certains concepts fondamentaux en psychiatrie.
Un changement de regard comme celui que propose la phénoménologie peut-il contribuer à déstigmatiser les troubles psychiques ?
Ça dépend de ce qu'on en fait. En soi, des concepts philosophiques ne changent pas la société. Mais on peut s'en servir comme outils dans les débats publics, pour changer les représentations.
Laissez-moi vous donner un exemple très concret avec l'approche biologique, pour vous montrer comment un simple changement de regard peut déstigmatiser. J'ai justement vu une patiente dépressive juste avant notre entretien.
Pour certaines personnes, la dépression est vraiment très biologique : tout va bien dans leur vie, elles n'ont rien fait de "mal", mais elles se dépriment. C'est de la chimie. Avec le bon traitement, elles vont mieux.
Le problème c’est que beaucoup de ces personnes se culpabilisent énormément. Elles pensent que c'est de leur faute, qu'elles sont "faibles", qu'elles devraient "se ressaisir". Quand je leur explique que c'est purement biologique, que leurs niveaux de sérotonine sont trop bas, qu'avec le traitement ça remonte et que c'est pour ça qu'elles iront mieux, c'est un soulagement immense.
Ce n’est pas une question de volonté, c'est comme avoir un diabète : personne ne se reproche d'être diabétique. Un discours très biologique peut donc être extrêmement déstigmatisant.
Et la phénoménologie peut jouer le même rôle ?
Exactement. Si on l'utilise pour montrer que les expériences psychotiques ne sont pas du "délire absurde sans queue ni tête", mais des façons différentes et cohérentes d'habiter le monde, ça change le regard. Si on montre que la dépression n'est pas de la "faiblesse" mais une transformation profonde du rapport au temps, ça déstigmatise aussi. Tout dépend de l'usage qu'on fait de ces concepts.
La philosophie, et notamment la phénoménologie, peut-elle aider les personnes dans leur rétablissement ?
Le rétablissement, c'est d'abord le cheminement propre de chaque personne. Pour avancer, chacun a besoin de trouver ses outils pour mieux comprendre ce qui lui arrive, se réapproprier son expérience, retrouver de l'autonomie.
Pour certains, ce sera la créativité artistique, l'engagement associatif, le sport, la spiritualité… Et pour d’autres, notamment celles qui ont un bagage philosophique, les concepts de la phénoménologie peuvent être de véritables outils. Si quelqu'un lit Binswanger ou Maldiney et que ça lui permet de mettre des mots sur son expérience, de comprendre autrement ce qu'il vit, alors oui, ça peut vraiment nourrir son rétablissement.
Mais je ne vais pas vous mentir : la philosophie n'est pas un outil universel. Ce serait malhonnête de le prétendre. mais pour certaines personnes, au bon moment, elle peut ouvrir des perspectives vraiment importantes. Au fond, tout peut servir au rétablissement : il faut juste que chacun trouve ce qui lui parle.
Si vous aviez carte blanche pour repenser la formation des psychiatres, donneriez-vous plus de place à la philosophie et plus largement aux sciences humaines ?
C'est une vraie question. Depuis 20 ans, il y a effectivement de plus en plus d'heures de sciences humaines dans les études de médecine. Le problème, c'est que souvent ces heures sont assurées par des médecins plutôt que par de vrais spécialistes de sciences humaines. Et quelques heures par semaine ne suffisent pas pour acquérir une vraie compétence dans ce domaine.
Pour être réellement formé en sciences humaines et en médecine, il faudrait un investissement considérable. Ce n'est pas réaliste d'exiger ça de tous les étudiants. Mais pour ceux qui le souhaitent, et qui s’intéressent à la philosophie, oui, il devrait y avoir des parcours permettant vraiment d'approfondir.
Ce qui est important, c'est de reconnaître qu'on ne peut pas tout maîtriser. Les médecins ne peuvent pas être à la fois médecins, philosophes, sociologues... L'essentiel est de rester ouvert, curieux, et de savoir qu'il existe d'autres façons de penser nos pratiques.
Pour finir, quels changements espérez-vous voir émerger dans la psychiatrie ?
Vous savez, je trouve que c'est une discipline déjà très dynamique ! Le présent de la psychiatrie est passionnant. Il se passe plein de choses intéressantes, il y a une vraie effervescence intellectuelle et pratique. Mon souhait ? Qu'on continue sur cette lancée, qu'on reste ouverts à la diversité des approches, qu'on ne s'enferme dans aucun dogme.
La richesse de la psychiatrie aujourd'hui, c'est justement qu'on peut croiser les regards : biologiques, psychologiques, philosophiques, sociaux. Et c'est cette diversité qui, au final, aide le mieux les personnes.
Le message de Camille Abettan est clair : il n'existe pas d'approche miracle en santé mentale. Mais changer notre façon de comprendre la maladie mentale peut transformer, même indirectement, la qualité de la relation de soin. Et c'est dans cette relation, enrichie par des regards multiples, que peut s'ouvrir l'espace du rétablissement.