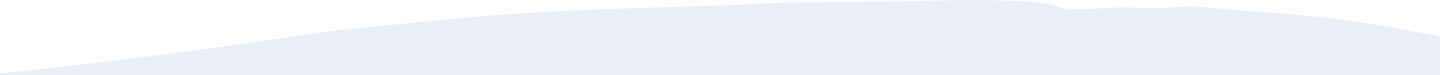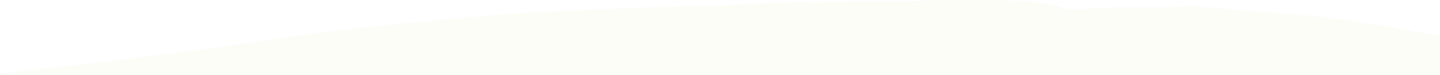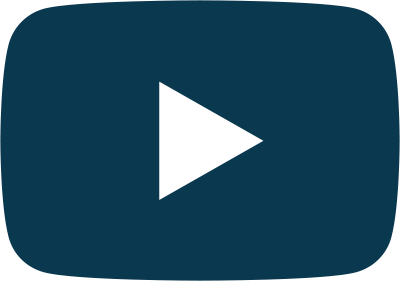Claire Touzard : Se réapproprier la “folie” pour reprendre du pouvoir
Qui est fou dans ce monde de fous ? Dans son ouvrage Folie et Résistance (éd Divergences, 2025), la journaliste et autrice Claire Touzard s’interroge sur la manière dont notre société perçoit et exclut la folie. Ce mot, moins présent dans la psychiatrie, continue d’être utilisé pour parler de celles et ceux qui ne rentrent pas dans la norme. En mêlant réflexion politique et expérience personnelle, elle nous explique comment la santé mentale sert encore trop souvent à juger, classer et mettre à distance.
Plein Espoir prend part à cette réflexion collective. Parce que vivre avec des difficultés psychiques ne relève pas seulement de soi. Cela concerne aussi les proches et appelle des appuis autour. Les Groupes d’Entraide Mutuelle, les Clubhouses ou la Mad Pride dont parle Claire Touzard montrent combien la communauté peut changer la donne. On y crée du lien quand tout isole, on y allège ce qui pèse sur les épaules, on y entend des expériences qui se répondent. On y retrouve peu à peu une capacité d’agir, une prise sur son parcours et une manière d’avancer, ensemble.
Ces mouvements s’inscrivent dans l’esprit du rétablissement, né de la volonté des personnes concernées de reprendre prise sur leur vie. Leur phrase fondatrice en dit toute la portée : rien à propos de nous sans nous. Cette approche change le regard. Elle s’éloigne d’une vision centrée sur le manque ou la maladie et rappelle que chacun peut retrouver une place, une voix, un chemin qui lui ressemble. Finalement, dans son récit, Claire Touzard montre que la “folie” ne se réduit pas à un stigmate. Elle éclaire plutôt les limites d’un monde qui exclut vite et nous éloigne parfois du réel. Elle ouvre aussi une invitation à réfléchir à ce qui permettrait, enfin, d’avancer ensemble.
Plein Espoir : Votre livre s’ouvre sur une expérience à la fois intime et politique. Qu’est-ce qui vous a donné envie d’en faire un récit ?
Claire Touzard : J’étais arrivée à un moment de ma vie où le mot folie s’imposait à moi, mais d’une manière différente. D’un côté, il y avait ce diagnostic de bipolarité qu’on m’avait donné et que je questionnais : selon quels critères, qui décide de ça ? Je voulais comprendre comment on établit ces diagnostics, ce qu’ils disent vraiment de nous.
En parallèle, il y avait ce mot folie qu’on utilisait souvent à mon sujet, notamment parce que j’étais féministe et que je prenais la parole sur des sujets politiques. Alors, je me suis demandé : qu’est-ce qu’on appelle vraiment la folie aujourd’hui ? Qui définit la norme, ce qui est raisonnable ou non ?
J’ai fini par voir que le corps médical, comme le politique, revendiquent chacun ce pouvoir de catégoriser et de contrôler. Et qu’ils se rejoignent, finalement, dans une même logique de normalisation. C’est ce lien que j’ai voulu explorer dans le livre : montrer comment la folie, loin d’être un simple diagnostic, peut devenir un lieu de résistance, à la fois intime et politique.
Plein Espoir : Vous rappelez que le mot folie a peu à peu disparu du vocabulaire médical. Pourtant, dès qu’une personne sort un peu du cadre, on la qualifie aussitôt de folle. Pourquoi ce terme revient-il si facilement quand il s’agit de discréditer une parole ou une idée ?
Claire Touzard : Parce que la folie convoque un imaginaire très fort, un imaginaire de peur et d’altérité. Les fous, ce sont ceux qu’on tient à distance. C’est une peur archaïque, presque viscérale. Traiter quelqu’un de fou a toujours été une manière de le disqualifier. Si on regarde l’histoire, tous les mouvements de contestation ont été confrontés à ça : les militants pour les droits civiques, les féministes, toutes celles et ceux qui ont remis en cause un ordre établi. Le mot fou a servi à décrédibiliser leur parole, à la réduire à une émotion, une impulsion, une irrationalité.
Le pouvoir valorise la raison, la force, la maîtrise tout ce qui s’oppose au passionnel à l’émotionnel, des qualités qu’on a longtemps attribuées aux femmes et aux minorités. C’est une façon très efficace de hiérarchiser le monde : d’un côté, ce qui aurait de la valeur et serait sérieux, de l’autre, ce qu’on renvoie du côté du désordre ou de l’excès. Historiquement, les femmes qui se rebellaient contre leur mari ou contre le patriarcat ont été enfermées, diagnostiquées hystériques, souvent avec l’aide du corps médical (sur ce sujet, nous vous conseillons la lecture de Mon vrai nom est Elisabeth, d’Adèle Yon, ndlr). La folie, l’hystérie, tous ces mots ont servi d’outils de contrôle, dans la continuité d’un ordre à la fois patriarcal et carcéral. Et c’est précisément ce que je questionne dans le livre : à quel moment le soin, ou ce qu’on présente comme tel, devient-il coercitif ? À quel moment ces mots, censés apaiser ou comprendre, servent-ils en réalité à maintenir un ordre politique et social ?
Plein Espoir : Et pourtant, on parle beaucoup de libération de la parole autour de la santé mentale, comme si nos fragilités étaient enfin reconnues, presque valorisées. Est-ce, selon vous, une réalité ou une illusion rassurante ?
Claire Touzard : Non, je ne crois pas que le fait d’en parler davantage signifie que la stigmatisation ait reculé. J’ai même l’impression que, paradoxalement, plus on en parle, plus une autre forme de dévalorisation s’installe : la moquerie, la banalisation. On entend souvent dire : “Ah, maintenant, tout le monde est bipolaire”, comme si le simple fait d’évoquer un trouble suffisait à le rendre dérisoire. La stigmatisation n’a pas disparu, elle s’est simplement déplacée. Aujourd’hui, elle passe par la dérision, et continue de nier la profondeur et la réalité de la souffrance psychique.
En fait, tout cela repose sur une échelle de valeurs profondément politique. Tant qu’on reste dans un monde capitaliste, ce qui est valorisé, c’est la capacité à mettre ses émotions de côté, à taire sa sensibilité pour s’adapter à un système fondé sur l’efficacité et la productivité. Dans ce cadre-là, exprimer sa fragilité est une faute. C’est pour cela, je crois, que de plus en plus de personnes ne s’y reconnaissent plus. Beaucoup refusent d’entrer dans ce moule et n’arrivent pas à s’y sentir bien. Les plus jeunes, notamment, s’auto-diagnostiquent, se disent hypersensibles, recherchent des réponses en ligne. Ce n’est pas seulement une mode : c’est une manière de dire je n’arrive pas à m’intégrer dans une société qui valorise ce que je ne suis pas.
Mais la vraie question, et c’est celle que je pose dans le livre, c’est : est-ce que ce sont ces personnes qui sont anormales à ne pas réussir à s’intégrer, ou est-ce la société qui est incapable d’accueillir leur sensibilité, leur différence, leur beauté ? Cette multiplication des diagnostics traduit, selon moi, une impasse : on pathologise des personnes qui ne font que réagir à un système violent. Le problème, ce n’est pas elles, c’est le monde dans lequel elles essaient de vivre.
Plein Espoir : Dans le livre, vous expliquez qu’en cherchant à gommer nos fragilités et à contenir nos émotions, la société finit par créer elle-même de la folie. C’est bien cela ?
Claire Touzard : Oui, je le pense. Bien sûr, il y a des personnes qui ont un terrain plus sensible que d’autres, mais j’ai du mal avec cette tendance à tout individualiser, à tout ramener à la génétique. D’ailleurs et c’est documenté, les traumatismes peuvent modifier la structure du cerveau. Autrement dit, ce qu’on vit, ce qu’on traverse, peut littéralement transformer notre cerveau. Il y a une part neurologique, mais il y a aussi tout le reste comme l’impact des traumatismes, de nos environnements, de nos sociétés, de la violence ordinaire qu’on subit. Tout cela façonne aussi notre psyché. Il ne faut pas l’oublier.
Le système actuel est très culpabilisant. On finit toujours par vous faire sentir que c’est de votre faute. Et surtout, il individualise tout : chacun est censé gérer son trouble, prendre son traitement, faire un effort sur soi. Alors qu’en réalité, le soin devrait être un effort collectif. Il passe aussi par la discussion, par le lien, par ce qu’on crée ensemble.
Plein Espoir : Vous dites que la folie, c’est une autre forme de lucidité. Est-ce cette lucidité-là qui dérange le plus, parce qu’elle met en lumière ce que la société préfère ne pas voir ?
Claire Touzard : Oui, je pense que beaucoup de personnes qui n’arrivent pas à s’intégrer sont, au fond, des personnes sensibles qui renvoient à la société l’image de sa propre violence. Ce sont elles qui perçoivent le plus finement ce qui ne va pas, et c’est précisément pour cela qu’on les considère comme vulnérables ou anormales. Alors qu’en réalité, elles sont peut-être les plus lucides.
Mais ce savoir-là dérange. Il est dangereux pour l’ordre établi, parce qu’il dévoile les failles du système. Dans le livre, je parle par exemple de la photographe américaine Nan Goldin. C’est une artiste qui a connu l’addiction, et qui, au moment où elle a gagné en reconnaissance, a utilisé sa voix pour dénoncer l’industrie pharmaceutique responsable de la crise des opioïdes. Elle a retourné sa fragilité en force politique et poétique.
Plein Espoir : Vous parlez de la honte, de la peur du jugement, de la violence des mots. Au moment où le diagnostic de bipolarité est tombé, vous dites avoir été laissée dans le flou. Qu’est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là ?
Claire Touzard : Déjà, mon diagnostic, je le remets en question. Il n’est pas complètement certain : j’ai vu d’autres psychiatres qui m’ont dit que, peut-être, je ne l’étais pas. Mais au fond, ce n’est pas tant une question de diagnostic. Dès lors qu’on se positionne en dehors des cadres établis, qu’on conteste, qu’on lutte, on finit toujours par être perçu comme une anomalie.
Dans le livre, je cite la philosophe Sara Ahmed, qui explique dans La promesse du bonheur que les féministes ont souvent été traitées de rabat-joie, au point que certaines ont fini par en faire un statut, une identité politique. C’est un peu la même chose avec la folie : à un moment, il faut accepter de regarder ce qu’on nous renvoie, de le questionner, voire de se le réapproprier. C’est une manière de transformer la stigmatisation en force.
Plein Espoir : Selon vous, le mot folie mérite-t-il d’être réhabilité, comme on a pu le faire avec d’autres termes autrefois stigmatisants ?
Claire Touzard : Aujourd’hui, il y a un vrai mouvement de réappropriation de ce mot. Certains collectifs le revendiquent, comme on l’a fait autrefois avec d’autres termes jugés péjoratifs. Je pense par exemple au mot queer, qui était une insulte avant d’être porté en étendard par les communautés LGBTQ+.
C’est un peu la même chose avec la folie. Des collectifs, comme ceux qui organisent la Mad Pride, cherchent à lui redonner du sens, à en faire quelque chose de vivant, de joyeux, d’assumé. En se réappropriant ce mot, on coupe l’herbe sous le pied de ceux qui l’utilisent pour nous marginaliser. Dire : Vous nous trouvez fous ? Eh bien, on l’est, et on l’assume à notre manière, c’est renverser le stigmate. Je n’ai pas peur de ce mot. Au contraire, je le trouve plus humain, plus juste, que les termes médicaux comme trouble mental, qui me semblent bien plus violents. Ces expressions se veulent bienveillantes, mais elles enferment, elles figent. La folie, c’est un mot vivant, un mot qui respire, qui laisse la place à la complexité et à la liberté.
Plein Espoir : Que faudrait-il repenser en priorité pour que notre société apprenne enfin à accueillir la vulnérabilité plutôt qu’à la stigmatiser ?
Claire Touzard : Il faut changer le système, mais aussi notre manière de regarder le monde. Repenser ce qu’est la diversité, la pluralité. Il faut retisser du lien social, c’est essentiel. Aller vers l’autre, au lieu de le diagnostiquer, de le stigmatiser. Réapprendre à vivre ensemble, à repenser le soin collectivement.
Ce que dit Claire Touzard apporte une lecture forte et personnelle de ce que peuvent représenter les troubles psychiques aujourd’hui. Si nous avons choisi de la mettre en lumière, c’est aussi parce que son point de vue s’inscrit dans un moment où la parole s’ouvre, où l’on accepte davantage de regarder ces questions autrement. Depuis le confinement, les récits se sont multipliés, les prises de conscience aussi, et cette diversité d’expériences a commencé à déplacer le regard collectif. L’année Grande Cause nationale dédiée à la santé mentale a montré que quelque chose est en train de bouger. Des associations, des proches, des collectifs d’entraide et des personnes concernées se mobilisent ensemble et font évoluer les regards. Peu à peu, ces questions commencent à trouver leur place dans une conversation un peu plus ouverte.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.