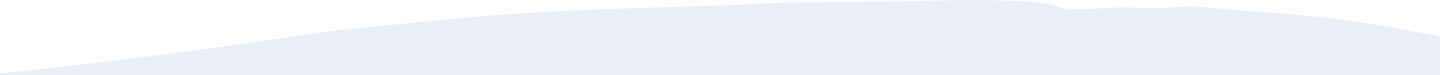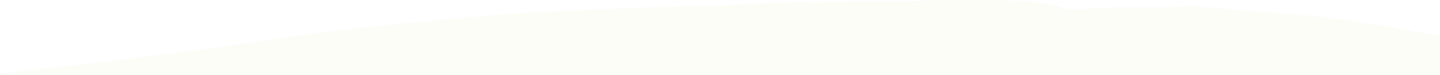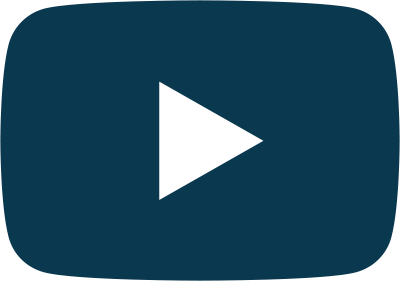Comprendre l’enfance auprès d’un parent en souffrance psychique : 5 oeuvres à voir ou lire
Grandir avec un parent concerné par un trouble psychique, c’est souvent apprendre très tôt à décrypter les silences, les humeurs, les absences. Des formes d’expression comme le cinéma, la littérature ou la BD permettent d’approcher ce vécu de manière sensible. Plein Espoir vous propose une liste d’œuvres offrant un regard juste pour mieux comprendre ces enfances pas comme les autres.
De nombreuses ressources existent aujourd’hui pour accompagner et rendre visibles ces vies. On peut citer la liste d’ouvrages publiée par l’UNAFAM, comme Mais qu’est-ce qu’ils ont, nos parents ? de Tytti Solantaus et Antonia Ringbom (2023), qui offre aux enfants dont un parent vit avec un trouble psychique des mots simples et des images douces pour comprendre, exprimer et apaiser ce qu’ils ressentent. La plateforme JEFpsy (Jeunes, Enfants, Familles & Psychiatrie) rassemble également albums, films, témoignages et outils pédagogiques adaptés à chaque catégorie d’âge dans sa médiathèque, tandis que la communauté Étincelles&co, qui répertorie des œuvres adaptées pour les grands et les petits. Dans cette même volonté de transmission et de compréhension, Plein Espoir a sélectionné plusieurs créations marquantes qui donnent à voir ce que signifie grandir auprès d’un parent en souffrance psychique.
Garder le cap, documentaire (2024) : trois jeunes racontent la santé mentale d’un proche
Partant du constat qu’au Québec, un jeune sur cinq a un proche atteint d’un trouble mental, le documentaire Garder le cap, réalisé par CAP Santé Mentale (une fédération d’associations pour proches de personnes concernées), donne la parole à trois jeunes Québécois, Joany, Dave et Marie, qui témoignent de leur expérience en tant que proches de personnes atteintes de troubles psychiques. La démarche vise à sensibiliser et encourager les jeunes vivant des situations similaires à chercher de l’aide. La partie consacrée à Joany raconte par exemple son parcours auprès de sa mère atteinte d’un trouble bipolaire. Enfant, Joany ressentait de la honte à inviter des amis chez elle et une forte culpabilité, tout en endossant malgré elle un rôle de mère pour ses frères et sœurs. En grandissant, elle réalise que sa mère n’était pas comme les autres mamans qu’elle pouvait côtoyer chez ses camarades. Six ans avant le documentaire, sa mère est enfin diagnostiquée, et c’est au cours de cette période que Joany comprend qu’elle doit couper les ponts pendant un certain temps afin de poser ses limites et se protéger d’une relation devenue trop toxique. Plus tard, mère et fille réussissent à rétablir le dialogue et à améliorer leur communication en parlant ouvertement de leurs attentes et de leurs blessures. Le documentaire montre une relation apaisée et complice, lors d’un pique-nique au bord de l’eau, toutes deux discutent du passé et de l’impact de la maladie avant le diagnostic. Joany y partage ce qu’elle a appris : qu’une maladie mentale n’empêche pas d’être fonctionnelle, qu’il faut écouter, comprendre, accepter et apprendre à vivre avec. Le documentaire propose comme forme de transition, une approche plus dans l’expertise, avec le regard de Gabrielle Brind'amour, directrice générale de L’Accolade Santé Mentale, une structure qui vient en aide aux personnes qui sont en relation avec un proche ayant un problème de santé mentale. Alors, à Plein Espoir, on s’est dit que cette démarche qui mêle témoignages et expertise pouvait venir étoffer la liste de nos articles, vidéos et podcast.
Le Perroquet – Espé (2017, BD, Glénat) : l’imaginaire comme bouclier
« Quand on se promène dans la rue, personne ne se rend compte que maman est malade depuis longtemps… sa maladie est invisible, silencieuse, honteuse » pense Bastien, le petit garçon de 8 ans que l’on aperçoit sur les planches monochromes de Le Perroquet. Point de vue à hauteur d’enfant, inspiré du vécu personnel d’Espé, ce récit graphique primé au Prix des patients 2017 mêle poésie et réalisme pour aborder avec pudeur la maladie mentale et la force de l’amour filial face à la fragilité d’un parent. Une approche authentique dont on recommande la lecture à Plein Espoir. « Maman, elle est comme Jean Grey dans les X-Men, elle peut exploser à tout moment ! » Pour affronter cette réalité, Bastien s’évade dans l’imaginaire, comparant sa mère à cette super-héroïne qu’il admire, mais qui est aussi incontrôlable et prête à exploser. On découvre la peur, la confusion et la tendresse qu’il ressent face aux crises de sa maman, ses séjours à l’hôpital et son impuissance dans le monde des adultes. Dans cette autofiction, Espé s’empare d’un sujet lourd et intime, celui de la dépression de sa maman et de sa cousine, ajusté à travers le filtre de l’enfance, à la fois naïf et profondément humain.
La Forêt de mon père – Véro Cratzborn (2020, film) : avoir un père « bigger than life »
Gina, 15 ans, aînée d’une fratrie de 3 enfants, vit au rythme des excentricités de son père, qu’elle adore. Mais lorsque la maladie s’installe, l’équilibre familial se fissure. Ce film franco-belge, pudique et sensoriel, capte avec précision ce moment où l’adolescence se mêle à la perte d’innocence. L’adolescente admire son père psychotique, dont on ignore le diagnostic à dessein, puisque c’est le regard de l'ado et de l’enfant, que l’on prive souvent de réponse, en raison de leur manque de considération dans les parcours de soins et le respect du secret médical. Une absence de réponse qui occasionne de l’incertitude et de la crainte. Celle de l'enfermement. La beauté du film réside aussi dans cette solidarité fraternelle face aux regards extérieurs malveillants et moins compréhensifs, qui n’hésitent pas à traiter de « taré » cette famille traversant une épreuve. La forêt devient alors à la fois un symbole de désordre et refuge face à cette intolérance. Vero Cratzborn est une réalisatrice qui s’est inspirée de sa propre enfance marquée par la maladie mentale de son père « bigger than life », où la folie était érigée en normalité. Dans une volonté de réalisme, elle a également collaboré pendant deux ans avec du personnel soignant et des patients en hôpital psychiatrique pour réaliser son film. « Le cinéma rassemble, quand dans la société on ne peut pas toujours être ensemble », livre la réalisatrice en guise de motif d’espoir.
Rien ne s’oppose à la nuit – Delphine de Vigan (2011, roman) : la maladie d’une mère, le regard d’une fille
Dans Rien ne s’oppose à la nuit (2011), Delphine de Vigan plonge dans la mémoire de son enfance aux côtés d’une mère lumineuse et tourmentée, vivant avec un trouble bipolaire. Elle raconte la fascination, la honte, la tendresse, les silences aussi, tout ce que la maladie installe dans le cœur d’un enfant qui observe sans comprendre vraiment. Lucide sans dureté, l’autrice décrit le désordre des jours, la beauté fragile des accalmies, la culpabilité de celle qui, devenue adulte, tente de dire sans trahir.
Le roman alterne le récit par des chapitres où elle conte la vie de Lucile et d’autres où elle décrit ses propres recherches et son désarroi pour tenter d’achever ce projet qui l’obsède. C’est cette structure, à la fois intime et réflexive, qui en fait une œuvre profondément différente des récits centrés uniquement sur la maladie : ici, la folie n’est pas un sujet clinique mais un prisme à travers lequel se dévoilent la mémoire, l’amour filial et la quête de vérité. Couronné par le Prix Renaudot des lycéens, Rien ne s’oppose à la nuit a marqué de nombreux lecteurs par sa justesse.
La collection Thérap’nimo (Magali Droz Chanson) : des animaux pour dire l’indicible
La collection Thérap’nimo, aborde avec une infinie délicatesse les réalités parfois invisibles de l’enfance auprès d’un parent en souffrance psychique. Conçue pour aider les enfants à mettre des mots sur ce qu’ils vivent, elle s’appuie sur la force symbolique des animaux pour parler de troubles difficiles avec justesse et douceur. Chaque album donne à voir un visage différent de la fragilité adulte : dans Lulu la petite luciole, le trouble dépressif d’un père fait vaciller la lumière familiale. Léon le petit caméléon explore le trouble bipolaire d’une mère, entre éclats et effondrements. Eline, la petite paruline, aborde la personnalité borderline, avec son intensité et ses dangers. Mathys le jeune loris raconte l’addiction à l’alcool d’une maman, vécue comme une inquiétude quotidienne. Martin le petit dauphin évoque la toxicomanie parentale et la peur qu’elle installe dans la vie de l’enfant. Ces histoires, pensées pour la petite enfance, ne cherchent pas à expliquer mais à reconnaître : reconnaître la tristesse, la culpabilité, la honte, l’amour aussi, et rappeler à chaque enfant qu’il n’est pas seul.
Ces œuvres, chacune à leur manière, rappellent qu’il est possible de parler de la maladie psychique sans tabou ni jugement, à hauteur d’enfant comme d’adulte. Elles ouvrent des espaces de compréhension et de dialogue, et offrent une manière juste de reconnaître la complexité de ces enfances, trop souvent tues ou invisibles. Chez Plein Espoir, on encourage à lire et découvrir sans modération ces productions !