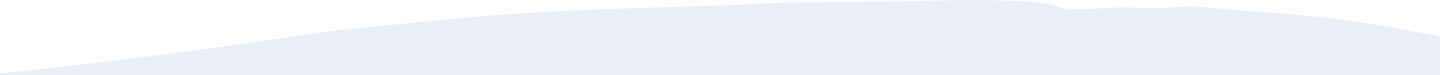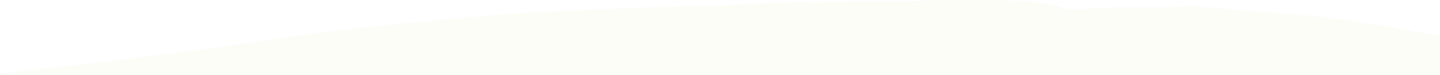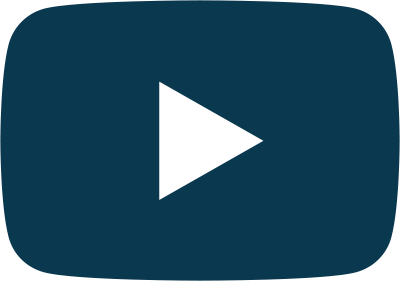“Elle a un caractère de feu” – L’enfance dans le flou des troubles parentaux
Pendant les années de leur enfance, ils ont vécu auprès d’un parent en proie à la maladie psychique, sans mots ou diagnostic pour comprendre, ni soutien pour en parler. Pour Plein Espoir, ils racontent avec leur recul d’adulte, l’enfance sous tension, l’aide qu’ils ont pu apporter à ce parent, mais aussi le chemin vers l’apaisement.
« J’ai longtemps cru que ma mère avait un caractère de feu. En fait, elle était malade », Richard 30 ans
Je ne saurais dire quand la maladie de ma mère a commencé. Il n’y a pas eu de moment clair, juste un glissement, une dérive lente. Enfant, je savais qu’il y avait des jours normaux et des jours où tout déraillait. Les disputes entre mes parents étaient violentes et interminables. Ma mère, paranoïaque, persuadée d’être trompée, hurlait, cassait des choses. Parfois, elle attrapait un couteau et tournait autour de moi ou de mon père, comme prise dans une spirale. D’autres fois, la violence prenait des formes plus sourdes, des portes qui claquaient, des silences, des regards lourds. C’était ça, le quotidien. Et moi, je me réfugiais dans ma chambre. Quand ça devenait trop fort, j’appelais les pompiers ou la police. C’était devenu un réflexe, presque un rôle, d’être ce petit garçon qui appelle les secours pour que la nuit se termine.
J’ai perdu mon père à l’adolescence et j’ai dû continuer à endosser ce rôle seul. Quand ma mère criait sur les voisins, j’allais m’excuser, dire qu’elle n’était pas dans son état normal. Je gérais les crises comme je pouvais. Le plus dur, c’était peut-être le silence autour de tout ça. Dans ma famille, on ne parlait pas de maladie mentale. On disait juste qu’elle avait un « caractère de feu ». On blaguait même en disant qu’elle était simplement de signe scorpion. Comme elle venait des îles Fidji, il y avait aussi ce discours un peu racisé, un peu commode : « Elle est comme ça, c’est son tempérament ». Chez nous, la folie n’existait pas. C’était impensable, presque honteux. Et d’où elle vient, on dit qu’une personne « folle » a offensé une divinité. Ça jette une ombre sur toute la famille. Alors on tait, on dissimule, on s’habitue.
J’ai poursuivi des études et fait mon chemin à l’âge adulte, en gardant cette préoccupation pour ma mère au quotidien. Une fois, je me suis réveillé au milieu de la nuit, mon chat, était perché sur le frigo, et ma mère le menaçait avec un couteau. J’ai eu très peur et ce jour-là, je me suis dit : ça suffit. J’ai fini par faire ce que personne n’avait fait dans la famille, l’emmener voir des spécialistes. J’avais moi-même consulté dans un CMP (Centre médico-psychologique) car je n’allais pas bien, et on m’y a aidé à comprendre que ma mère avait probablement un trouble schizophrénique. Avec le centre, j'ai monté un petit plan : j’ai dit à ma mère que j’avais besoin d’elle pour un soin pour qu’elle accepte de venir. Une fois sur place, les soignants ont vite compris et dix minutes plus tard, ils m’ont dit qu’il fallait l’hospitaliser. C’était pendant le Covid, j’avais 27 ans. Et tout s’est enchaîné.
Ce qui m’a frappé, c’est la simplicité du geste après tant d’années de peur. Un rendez-vous, quelques mots, et enfin une prise en charge. Pendant des années, on a souffert d’un secret qu’on n’avait jamais osé nommer. Avec le temps, j’ai bien compris qu’on s’habitue à tout, et même à la violence. Quand elle est quotidienne, elle devient le fond du décor. Les portes qui claquent, les insultes, les objets cassés, tout ça devient normal. Enfant, je croyais que c’était ça la vie de famille. Ce n’est que plus tard que j’ai mesuré le poids de cette hyper vigilance constante, cette peur qui me suit encore aujourd’hui, dans la rue, quand je me retourne sans raison.
Il y a eu aussi de la honte. Ne jamais inviter d’amis, de peur qu’elle fasse une scène, ou cette expérience douloureuse le jour où elle a insulté ma copine, sans raison. J’aurais voulu disparaître. Ces moments laissent des traces. Dans ma vie d’adulte, la responsabilisation ne m’a pas quittée, mais elle a changé de forme. Je sais aussi que j’ai gardé un « syndrome du sauveur ». Cette tendance à vouloir réparer, à me sentir responsable du mal-être des autres. Peut-être parce que j’ai grandi en pensant que c’était mon rôle. C’est difficile à désapprendre. Aujourd’hui, ma mère va mieux. Elle est entourée de ses chats, elle prend ses traitements, elle est apaisée. J’ai appris à la regarder autrement, sans colère. À la place de la peur, il y a de la compassion. Je veille toujours sur elle et je veux qu’elle vieillisse dans de bonnes conditions, qu’elle ait une maison, un monte-escalier, un espace à elle.
« Enfant, je sentais que ses câlins étaient plus pour elle-même que pour moi »,
Théo, 37 ans.
Je crois que j’ai toujours su que ma mère avait « quelque chose ». Enfant, je la voyais passer de phases d’énergie débordante à des périodes de silence et de déprime. J’ai encore cette image d’elle, assise des heures devant la cheminée sans rien dire, à se toucher les cheveux frénétiquement, perdue dans ses pensées. Je sais aujourd’hui qu’elle a un trouble bipolaire. Mais d’un point de vue extérieur à l’époque, mon cercle social la voyait comme une artiste hippie, jeune et décalée, lorsqu’elle venait me chercher à l’école dans sa vieille Peugeot 104 rouge. Mes copains trouvaient ça cool. De mon côté, je sentais un décalage avec les autres parents de mes amis, j’étais fier d’avoir une mère “à la cool” et jeune dans sa tête, mais j’étais aussi un peu frustré parfois, de ne pas avoir une figure maternelle un peu plus comme les autres. Je la sentais émotionnellement très fragile et instable, ce qui était peu rassurant.
Dans sa famille, le terrain était là, avec notamment un grand frère qui avait connu des épisodes de délires paranoïaques. La grande sœur de ma mère était aussi probablement atteinte d’un trouble bipolaire, comme elle. Lorsque celle-ci décède d’un cancer, ma mère ne lui parlait déjà plus depuis de nombreuses années. C’est sa mort qui a tout fait basculer. Ma mère a décompensé, elle a été hospitalisée, puis tout s’est effondré. Séparation, isolement, déséquilibre complet. J’avais 23 ans, en plein dans mes études, avec la vie étudiante qui battait son plein. Et soudain, la réalité m’a rattrapé. Quand mon père m’a annoncé son hospitalisation, j’ai ressenti un mélange étrange, un choc, mais aussi comme un soulagement. Soulagé d’avoir enfin une explication à ce sentiment diffus de toute une enfance, cette impression que ses câlins étaient plus pour elle-même que pour moi.
Lorsque j’avais besoin d’elle, j’avais toujours le sentiment que c’était elle qui avait besoin de moi. Nous étions très fusionnels et elle se reposait beaucoup sur ce soutien. J’avais endossé ce rôle pour elle : la remotiver, la rassurer, elle qui se dévalorisait en permanence. Ma mère n’a pas eu d’emploi stable, alors j’endossais probablement une responsabilité un peu trop lourde à porter, quand mon père était à son travail.
Et en même temps ce rôle m’a donné un sens des responsabilités, de l’empathie et m’a façonné. D’ailleurs, ce n’est probablement pas un hasard si mon parcours professionnel m’a mené vers le domaine de la santé mentale, sans doute pour trouver du sens et des réponses. Du point de vue personnel, je garde dans ma vie d’adulte, cette tendance à anticiper les besoins des autres plutôt que les miens, à me suradapter. Je capte les micro-changements d’humeur de mes proches, je surinterprète aussi parfois, je reste en vigilance, comme j’ai appris à anticiper les phases de down de ma mère durant mon enfance. Ça peut être une intuition utile, mais dans la vie intime, ça peut aussi devenir envahissant pour les autres, et source d’inquiétude inutile pour moi.
Après sa sortie d’hôpital, ma mère s’est éloignée et alternait paranoïa, dépression et phases d’euphorie. J’ai repris contact doucement et c’est à ce moment-là qu’elle a accepté une rencontre avec une psychiatre. Celle-ci nous a réuni, ma petite sœur, ma mère et moi, pour nous expliquer ce qui se passait. Elle nous a décrit son trouble et nous a dit de manière très directe : « Vous ne retrouverez pas la même relation qu’avant, vous devez vous protéger tous les trois. » Sur le moment, j’ai trouvé ça dur, presque violent. Mais en sortant, j’ai compris qu’on avait enfin quelqu’un qui posait les mots et nous autorisait à ne pas porter le fardeau de la situation. Grâce à ça, ma sœur et moi avons trouvé un équilibre avec notre mère.
Aujourd’hui, elle est stabilisée grâce à son traitement. Nos échanges sont simples, on s’appelle de temps en temps, on parle un peu de banalités, et ça s’arrête là. On garde le lien, mais à petite dose, ce qui nous permet de nous protéger aussi, ma soeur et moi. Avec le recul, je dirais que je n’ai pas “accompagné” ma mère dans le sens où je l’aurais accompagné dans sa prise en charge, mais je pense avoir joué un rôle inconsciemment, en la soutenant au quotidien, et en la comprenant, enfant, sans véritablement la comprendre.
Le regard de Frédérique Van Leuven, psychiatre : « Ce n’est pas mal d’aider. Ce qui l’est, c’est de le faire seul »
Derrière les récits de Richard et Théo, une même question revient : que vivent vraiment ces enfants qui grandissent auprès d’un parent en souffrance psychique non diagnostiquée ? Comment comprendre leurs réactions, l’hypervigilance, la culpabilité, le besoin de réparer face au manque d’informations ? Pour y voir plus clair, nous avons rencontré Frédérique Van Leuven, psychiatre, auteure de Grandir avec des parents en souffrance psychique (avec Cathy Caulier, 2017) et membre de la communauté de pratique Étincelles & co.
« Ce qui est compliqué pour ces enfants, explique Frédérique Van Leuven, c’est qu’ils vivent des situations étranges qu’ils ne savent pas nommer. Ils perçoivent que certaines choses ne se passent pas comme ailleurs, chez les copains, à l’école, mais personne ne leur explique. » La psychiatre se souvient d’Alice, une jeune femme dont la mère non diagnostiquée disait parfois : “Aujourd’hui, je ne fais pas à manger, je suis morte.” Enfant, Alice répétait cette phrase à sa sœur sans comprendre. « Plus tard, elle dira : on me traînait chez les psys parce que j’avais des problèmes à l’école, et eux n’ont pas vu que ma mère était psychotique. ils pensaient que c’était moi le problème. » Ces enfants, poursuit la praticienne, deviennent souvent les soutiens silencieux du parent malade : « Ils endossent des rôles d’infirmier, d’assistant, de confident. C’est très lourd, et cela peut mener à la confusion, à la perte de repères et au conflit intérieur. » Alice a ainsi dû séjourner en psychiatrie. C’est là, qu’enfin, un membre du personnel soignant a mis des mots sur le probable trouble de sa mère.
Si ces enfants soutiennent très activement le parent, la plupart du temps, ils en ignorent les raisons et n’obtiennent aucune gratification ou remerciement pour leurs actions, ce qui les mène parfois à l’épuisement. « Et c’est très fréquent que ce soit lorsque l’enfant n’en puisse plus et demande de l’aide qu’on peut identifier la situation », explique la psychiatre. Mais Frédérique Van Leven insiste : « Aider ses parents n’est pas mal. C’est profondément humain. Ce qui ne va pas, c’est d’être seul à le faire. » Souvent, c’est quand ces enfants, devenus adultes, cherchent de l’aide pour eux-mêmes qu’une prise de conscience s’ouvre. Certains deviennent d’ailleurs soignants, éducateurs, thérapeutes. « Ils découvrent qu’ils ont été “formés” à l’écoute et au soin depuis longtemps, sans le savoir », note-t-elle. Pour la psychiatre, la clé réside dans la parole de l’enfant. « Les enquêtes montrent que dans le secondaire, au moins un à deux enfants par classe sont des jeunes aidants qu’on ignore. À l’école, on devrait parler de santé mentale dès la maternelle. Quand un enfant commence à s’exprimer, il doit trouver une oreille chez les adultes encadrant. Une écoute qui permet d’informer sans stigmatiser, d’accueillir sans juger. C’est déjà beaucoup. »
Grandir avec un parent malade qu’on ne soigne pas, c’est grandir dans le flou. Un flou fait de silence, de peur et d’amour mêlés. On apprend très tôt des responsabilités, on s’efface pour protéger. Et un jour, on comprend que ce qu’on croyait « normal » ne l’était pas du tout. Nommer la maladie, c’est déjà la reconnaître. Et c’est souvent le début d’un soulagement, pas seulement pour le parent, mais pour toute la famille.
Image d'illustration générée par IA