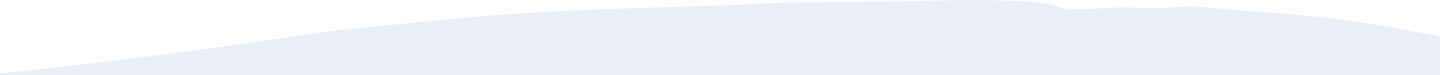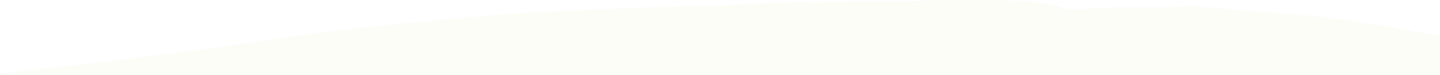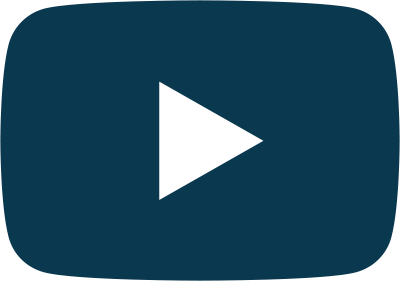Faire communauté pour aller mieux et faire valoir ses droits
Faire communauté quand on vit avec des troubles psychiques n’a rien d’évident. Pourtant, pour les personnes concernées et leurs proches, le collectif permet de rompre l’isolement, de partager des expériences et de se soutenir. Entre entraide, rétablissement et engagement, la communauté devient un appui essentiel pour aller mieux et faire respecter ses droits.
En France, le mot « communauté » fait souvent peur. Concernant la santé mentale, on lui reproche souvent de mettre tout le monde dans la même case, de stigmatiser, ou d’effacer la façon très personnelle dont chacun vit avec ses troubles psychiques. Dans les faits, pour les personnes concernées et leurs proches aidants, il se passe souvent l’inverse. Le groupe ne gomme pas les individualités. Il aide d’abord à ne plus se sentir seul.
« Aujourd’hui, nous sommes deux millions d’usagers en santé mentale en France », rappelle l’association Comme des fous dans son manifeste. Un chiffre qui montre que ce que chacun traverse dans son coin correspond, en réalité, à des expériences largement partagées. Chaque année, l’association organise la Mad Pride, une marche joyeuse et engagée pour rendre visibles les troubles psychiques et sortir la santé mentale du silence et de la honte. Elle dit aussi que la santé mentale n’est pas seulement une affaire intime ou médicale, mais un enjeu social et citoyen, qui touche à l’accès aux droits, à la reconnaissance et à la place que la société accorde à celles et ceux qui vivent avec des troubles psychiques.
« Une personne sur trois connaîtra un trouble psychique au cours de sa vie. Et si l’on inclut les proches qui vivent avec cette réalité au quotidien, alors nous sommes tous concernés », rappelle Roselyne Daniel, médiatrice de santé pair à l’hôpital de Novillars, en Franche-Comté. De près ou de loin, parfois sans même en avoir conscience, nous appartenons tous à la communauté de la santé mentale. Dès lors, faire communauté n’est pas une option militante réservée à quelques-uns. C’est une réalité ordinaire de la vie sociale.
Sortir de l’isolement, reprendre sa place
Mais que signifie, concrètement, faire communauté ? Pour les personnes concernées par des troubles psychiques et leurs proches, cela commence souvent par quelque chose de très simple : sortir de l’isolement. Pouvoir parler avec d’autres qui comprennent, qui ont vécu des choses similaires, sans avoir à tout expliquer. C’est aussi comprendre ce à quoi on a droit, repérer ce qui est normal ou non, savoir quand une limite a été franchie. Des apprentissages qui passent rarement par les institutions, mais souvent par les autres.
Enfin, pour faire communauté, il faut penser la vie au-delà du soin. Ne pas se définir uniquement par un suivi médical ou par une maladie. « L’enjeu, c’est de retrouver une place dans le monde », rappelle l’association Comme des fous. Pouvoir travailler, aimer, s’autoriser à faire des projets. Avoir une vie qui ne soit pas organisée uniquement autour des rendez-vous médicaux.
Bien sûr, il ne s’agit ni de nier un diagnostic ni de refuser les soins lorsqu’ils sont nécessaires, mais de ne pas réduire une personne à une seule étiquette. « Être reconnu comme malade peut être nécessaire à un moment donné. Y être réduit en permanence, ça finit par enfermer », explique Vincent Girard, coordonnateur d’une équipe de santé communautaire à Marseille pour l’Assistance publique–Hôpitaux de Marseille et Médecins du Monde. En ce sens, le collectif permet de reprendre prise sur sa trajectoire et de redevenir acteur de sa vie.
Une culture du soin encore très verticale
Pourtant, en France, les personnes concernées et leurs proches peinent encore à avancer ensemble et à se rendre visibles. Une difficulté que Vincent Girard relie à notre histoire et à notre éducation. Dès l’école, on apprend très tôt à repérer ce qui ne va pas, à être sanctionné à la moindre erreur, à éviter de se tromper. « On passe beaucoup de temps à analyser les problèmes », observe-t-il. Une habitude peu tournée vers le positif, qui finit, à force, par fatiguer plus qu’elle n’aide.
Cette manière de voir le monde se retrouve aussi dans la façon dont la médecine fonctionne encore aujourd’hui. Un modèle très vertical, avec les soignants d’un côté et les patients de l’autre. En santé mentale, cela se traduit par des parcours pensés de façon très individuelle, souvent vécus dans la solitude.
« Notre culture est encore très individualiste », regrette Vincent Girard. Chacun est renvoyé à son histoire, à ses difficultés, à son parcours personnel. Dans ce contexte, se rassembler n’a rien d’évident. À force de vouloir tout discuter, tout analyser, tout confronter, les échanges se tendent. Les débats deviennent des lignes de fracture.
Faire communauté ne signifie pourtant pas penser tous pareil ni vivre les mêmes choses. Pour Vincent Girard, une communauté ne se décrète pas. Elle se reconnaît. « Une communauté, c’est des gens qui se reconnaissent. Ça commence déjà par une manière de parler, une manière de se regarder. »
Apprendre ensemble, autrement
La communauté de la santé mentale doit se construire à partir de ce que les personnes vivent. Dans certaines pratiques de santé communautaire, comme la thérapie communautaire intégrative, une règle est posée dès le départ : on ne donne pas d’avis. On partage uniquement ce que l’on a vécu, ce qui nous a aidé, ce qui a fonctionné pour nous.
Le problème n’est pas nié, mais il n’est plus le centre de tout. Ce qui compte, ce sont les solutions expérimentées. Ce déplacement change profondément la dynamique des groupes. Il apaise les tensions. Il remplace la confrontation par l’inspiration. Plus on parle de ce qui marche, plus on renforce l’espoir et l’envie d’agir.
Dans cette logique, l’erreur n’est plus vécue comme un échec. Elle devient une étape normale de l’apprentissage. « Tant qu’on n’a pas intégré que l’erreur fait partie du processus, on reste dans une culture anxiogène », insiste Vincent Girard. Apprendre, c’est se tromper. Et apprendre ensemble, c’est accepter de se tromper à plusieurs.
Le rétablissement, reprendre le pouvoir sur sa vie
Cette approche rejoint celle du rétablissement, encore mal comprise en France. Né dans les années 1970 dans les pays anglo-saxons, ce mouvement a d’abord été porté par les personnes concernées elles-mêmes, notamment Patricia Deegan et Bill Anthony, qui revendiquaient le droit de reprendre le contrôle de leur vie.
Longtemps, en France, la psychiatrie a parlé surtout de stabilisation ou de rémission, laissant penser que les troubles étaient forcément chroniques. Or, les études montrent qu’un grand nombre de personnes peuvent se rétablir, totalement ou partiellement, et mener une vie satisfaisante.
Le rétablissement n’est pas la guérison au sens médical. Il concerne le devenir de la personne. Comme l’a montré Samantha Copeland, il repose sur plusieurs piliers : l’espoir, la responsabilité personnelle, l’accès à l’information, la capacité à défendre ses droits et le soutien des autres. Se rétablir, c’est reprendre le contrôle de sa vie, retrouver des liens sociaux, avancer vers le projet de vie que l’on choisit. Un chemin qui n’est ni linéaire ni définitif, mais qui se construit dans la durée.
Faire communauté pour faire valoir ses droits
La communauté n’est pas seulement un espace de soutien. Elle est aussi un lieu où l’on apprend à faire valoir ses droits. « C’est un endroit où quelqu’un peut te dire : attention, là, tes droits ne sont pas respectés », résume Vincent Girard. Face aux institutions, cette vigilance collective change tout. Mais militer quand on vit avec des troubles psychiques n’a rien d’évident. Cela demande du temps, de l’énergie, du soutien. Et des ressources que tout le monde n’a pas. Bien sûr, l’engagement associatif ne peut pas compenser à lui seul les failles du système, mais il permet de les rendre visibles.
Pour Roselyne Daniel, consacrer du temps à faire avancer la cause de la santé mentale est devenu essentiel. Bénévole très investie au sein du Conseil local de santé mentale du Grand Besançon, un espace de concertation territoriale qui réunit élus, professionnels de la santé mentale, acteurs du social et du médico-social, ainsi que des personnes concernées, elle coanime des débats auprès du grand public. « C’est très important pour moi de m’investir, même si ce n’est pas toujours simple à concilier avec ma vie de jeune maman, confie-t-elle. Si je peux le faire, c’est aussi grâce au soutien de mon compagnon, qui est mon aidant. »
L’an dernier, cet engagement l’a amenée à prendre la parole lors d’un colloque sur la santé mentale organisé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à Paris. Elle y a rappelé l’urgence de placer la santé mentale au cœur de toutes les politiques publiques. « Tout le monde n’a pas les moyens de parler. C’est aussi pour celles et ceux qui ne le peuvent pas que je veux nous faire entendre », explique-t-elle.
Le parcours de Roselyne Daniel montre que militer ne consiste pas à parler plus fort que les autres, mais à porter une parole pour ceux qui ne le peuvent pas. Être isolé ne signifie pas être sans droits. En revanche, c’est souvent à plusieurs que ces droits peuvent être reconnus et défendus. Face aux institutions, la solitude fragilise. Le collectif, lui, permet de partager les expériences, de faire circuler les stratégies, et peu à peu de rééquilibrer le rapport de force. Militer ne commence pas toujours dans la rue ou sur une tribune. Bien souvent, cela commence simplement par ne plus être seul face au système.
Quel rôle pour les pouvoirs publics, quel rôle pour la société ?
Faire communauté pose inévitablement une question politique. L’accès aux soins, la continuité des parcours, la reconnaissance de l’expertise des personnes concernées, la lutte contre les discriminations relèvent aussi de choix publics.
« En France, la santé mentale reste encore trop souvent cantonnée au champ médical, alors qu’elle traverse l’ensemble des politiques publiques : logement, travail, éducation, justice, protection sociale », explique Roselyne Daniel. Faire communauté ne dispense pas l’État de ses responsabilités. Au contraire, cela permet de les formuler, de les rendre visibles, parfois de les rappeler.
Cette responsabilité ne repose pas uniquement sur les pouvoirs publics. Elle interroge aussi la place des citoyens. Proches, collègues, employeurs, voisins : la manière dont une société accueille les parcours fragiles, accepte les discontinuités, écoute les récits et ajuste ses normes dit quelque chose de sa capacité à faire société.
Une autre façon de penser la santé mentale
Faire communauté, en santé mentale, ce n’est ni se replier ni s’enfermer dans une identité. C’est accepter que la vulnérabilité fait partie de la vie. Reconnaître que l’on apprend mieux à plusieurs. Que le rétablissement se construit rarement seul. Et que la confiance se tisse dans les liens du quotidien.
Comme d’autres luttes avant elle — LGBTQ+, autour du VIH ou contre le racisme — la santé mentale avance souvent grâce aux collectifs. Non pas contre les institutions, mais pour les transformer. En rendant visibles des expériences longtemps reléguées au silence, ces communautés déplacent peu à peu les normes, les pratiques et les regards.
Dans les pays qui ont investi dans les compétences psychosociales, cette approche a profondément changé la manière de vivre ensemble. Le sentiment de confiance est devenu un repère central du bien-être. Une autre façon de penser la santé, non plus seulement comme une affaire individuelle, mais comme quelque chose qui se construit collectivement, dans les relations et le soutien mutuel. « On a découvert comment être heureux », rappelle Vincent Girard. Une phrase qui peut surprendre. Elle dit pourtant une chose simple : faire communauté, c’est créer les conditions pour que chacun puisse aller mieux, à son rythme, avec les autres.