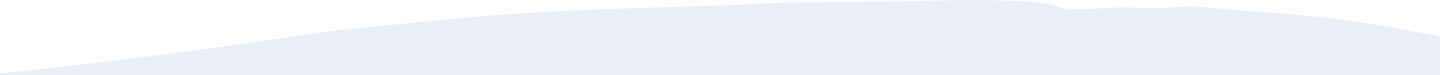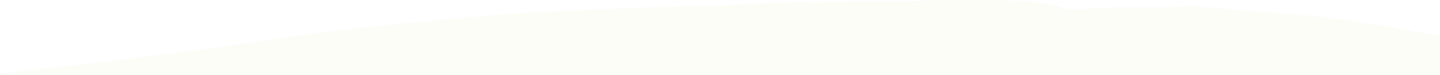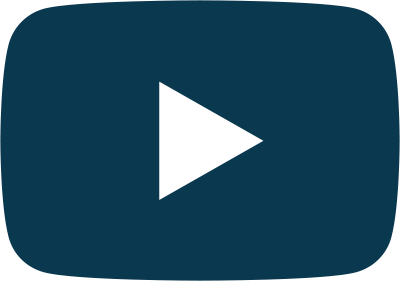« Glass child » ou l’enfant invisible face à la maladie d’un parent
Des milliers d’enfants grandissent aux côtés d’un parent en souffrance psychique. Pour ces « jeunes proches », l’empathie et le sens des responsabilités peuvent devenir une seconde nature. Mais ils composent aussi avec la peur ou l’isolement, parfois jusqu'à l'effacement. Plein Espoir a rencontré Hélène Davtian, psychologue, membre de l’association Étincelle & Co — qui anime une communauté de pratique dédiée aux « jeunes proches » et à la parentalité en psychiatrie. Elle plaide pour des réponses concrètes : reconnaître leur place dans les parcours de soins en formant les équipes à les accompagner, sans les réduire à de simples « aidants juniors ».
Plein Espoir : Quand on grandit avec un parent en souffrance psychique, est-ce qu’on grandit comme tous les enfants ?
Hélène Davtian : Un enfant qui grandit avec un parent qui vit avec un trouble psychique, s’adapte en permanence. Ces enfants font de gros efforts de régulation de leurs émotions, tentent de comprendre, s’ajustent aux fluctuations de la maladie. On les appelle parfois des « glass child », des enfants transparents qui vont tout faire pour être invisibles et ne pas attirer l’attention sur leur famille. C’est ce qu’on appelle l’aide par l’effacement. Beaucoup d’enfants taisent leur vécu par peur d’être séparés de leur parent ou crainte qu’il soit hospitalisé de force. Ces enfants ne produisent en général pas de symptômes… jusqu’au moment de l’émancipation, où beaucoup craquent. Une jeune femme me disait récemment : « Comment entrer dans ma vie d’adulte alors que je n’ai jamais été une enfant ? » Cette adaptation forcée a un coût.
Plein Espoir : Quels ressentis reviennent le plus souvent ?
Hélène Davtian : Les enfants évoquent l’isolement, la honte, la culpabilité, l’insécurité. L’adolescence par exemple agit comme un miroir qui active un questionnement envahissant sur l’identité, accentue le décalage entre corps et esprit, et nourrit la peur de « devenir malade » à son tour. Ces émotions résonnent directement avec la souffrance du parent. Elles sont très présentes, mais rarement exprimées. Les adolescents, par exemple, disent souvent que « tout va bien ». Pour connaître l’expérience vécue des enfants d’aujourd’hui, nous travaillons surtout par approches rétrospectives avec des adultes.
Plein Espoir : On parle parfois d’un phénomène de parentification des enfants. De quoi s’agit-il ?
Hélène Davtian : Tout enfant, face à un parent fragile, essaie de compenser, il requalifie son parent, le soutient et devient en quelque sorte son co-parent. Cette parentification à petite dose, sous forme de solidarité ou d'empathie, n'est pas problématique dans une famille. Le problème, c’est quand l’enfant est figé dans cette posture, il s’épuise et ne peut plus tenir cette place et être à la fois, un enfant en apprentissage. Il y a parfois de la gratification à être un enfant « très mûr », mais aussi des situations trop lourdes, parfois traumatisantes. Certains disent « je ne veux plus jamais voir ma maman ». Ces paroles doivent être entendues. Si elles ne le sont pas, on met en danger la santé mentale de l’enfant.
Plein Espoir : Aider son parent lorsqu’on est en capacité de le faire peut avoir des effets positifs, mais où placer les limites ?
Hélène Davtian : L’enfant peut soutenir, mais cela ne doit pas être quelque chose qu’on attend de lui. Or, ils sont très généreux et vont souvent au-delà pour soulager leur proche. Par exemple, certains accompagnent leur parent dans un délire pour qu’il ne soit pas seul. C’est donc aux adultes de dire : « Là, ce n’est pas ta place. ». Avec Étincelle & Co, nous avons conçu un petit baromètre pour qu’un adulte puisse aider un enfant à aborder ses limites. En psychiatrie, la question des limites est centrale et il faut placer ces limites à la maison également.
Plein Espoir : Vous privilégiez le terme « jeunes proches » à celui de « jeunes aidants » qui est pourtant officiel. Pourquoi ce choix ?
Hélène Davtian : « Jeunes aidants » vient d’une définition anglo-saxonne. Il s’agit de jeunes de tous âges, apportant une aide significative, toutes pathologies confondues. Bien que le terme se soit imposé dans les politiques publiques, il soulève quelques questions, car on considère l’enfant comme un aidant junior dont on valorise l’apport sans fixer de limites. Dans le même temps, le plan stratégique du gouvernement sur les aidants, développe un volet jeunes aidants où ces derniers doivent prouver qu’ils sont aidant pour recevoir une aide. Sur un plan éthique et au regard de la CIDE (Convention internationale des droits de l’enfant), un enfant ne devrait pas avoir à prouver une contribution pour recevoir de l’aide. Aujourd’hui, on demande souvent une attestation MDPH de la personne aidée pour ouvrir des droits. C’est plutôt simple pour un parent en fauteuil roulant, mais beaucoup moins pour un parent qui refuse le terme « malade ». Avec le terme « jeunes proches », on inclut aussi ceux dont le parent ne se reconnaît pas malade.
Plein Espoir : La considération des enfants doit-elle être davantage prise en compte dans les soins psychiatriques ?
Hélène Davtian : Oui. On vit une époque où la santé est en crise. En 2016, le rapport La Fourcade relatif à la santé mentale, affirmait que le domicile devait devenir le centre de gravité des soins psychiatriques, l’hôpital n’étant plus qu’une exception. Au-delà de la dimension thérapeutique de l’ambulatoire, il y a une dimension économique à faire basculer la charge vers les familles. Mais dans ce rapport, il n’y a pas un mot sur qui est à domicile. Or, dans ces familles, il y a des enfants, des ados et des jeunes adultes dont on ne parle pas ou très peu dans l’organisation des soins. Quand on dit « familles », on pense encore et avant tout aux adultes sur qui repose ce système. En sortie d’hospitalisation psychiatrique, on ne se préoccupe pas de savoir si des enfants sont concernés. Or, il y a là une dimension traumatique qui est rarement retravaillée. Après une crise, l’enfant voit le parent partir en ambulance, puis revenir et personne ne lui parle de ce qui s’est passé.
Plein Espoir : L’invisibilisation de ces enfants dont vous parlez, complique-t-elle le repérage et la prévention ?
Hélène Davtian : Oui totalement. En France, il n’existe pas de chiffres car la configuration familiale est une donnée médicale, et pas administrative. On s’appuie sur des chiffres étrangers et, en les croisant à l’échelle basse, on peut estimer qu’un tiers des personnes suivies en psychiatrie sont parents d’au moins un enfant mineur. Et pourtant, on en parle très peu. Sans oublier les frères et sœurs. Lorsque je dirigeais une maison des parents en Seine-Saint-Denis, j’ai pu constater un certain vide. Impossible de savoir, via le CMP, quels patients étaient aussi parents. Plus largement, les dispositifs de soutien à la parentalité existent, mais ils sont souvent mal à l’aise avec la question du handicap psychique. Les CLAP (centres de loisirs à parité), qui se déploient dans les régions, abordent la question, mais dans une approche « multi-handicap » qui n’intègre pas toujours la spécificité de la santé mentale. Il y a donc un vrai travail à mener. Notre communauté de pratique veut justement porter cette réflexion, dans une approche polyphonique et holistique.
Plein Espoir : Quelles solutions peuvent être mises en place après hospitalisations et lors du retour à domicile ?
Hélène Davtian : En Belgique, le Dr Frédérique Van Leuven a créé des espaces familles dans les hôpitaux psychiatriques. Nous préconisons la même logique : appliquer les droits de l’enfant en psychiatrie adulte, comme ailleurs. Quand un parent part en ambulance, l’enfant doit pouvoir être rassuré, savoir s’il va bien ou simplement recevoir un câlin s’il en a besoin. Or certains hôpitaux interdisent encore l’accès aux enfants de moins de 15 ans. C’est un vrai problème de démocratie sanitaire. L’enjeu n’est pas de surcharger des équipes déjà épuisées, mais d’organiser le système en formant les soignants en psychiatrie adulte (un patient reste aussi un parent) et soutenir les professionnels de la protection de l’enfance, qui accompagnent eux aussi de nombreux enfants dont les parents vivent avec des troubles psychiatriques.
Plein Espoir : Pour terminer, pouvez-vous nous indiquer des dispositifs qui pourraient venir en aide aux familles ?
Hélène Davtian : Il y a les Funambules, aujourd’hui gérés par la Fondation Falret (acteur engagé auprès des familles et adhérent de la fédération Santé mentale France), qui propose un accompagnement pour les jeunes de moins de 30 ans dont un proche est en souffrance psychique, la Pause Brindille, qui développe une communauté de soutien de pairs de manière intergénérationnelle. Grâce à des dispositifs comme JEFpsy (Pour Jeune Enfant Fratrie, une plateforme de soutien pour les jeunes ayant un frère, une sœur ou un parent vivant avec des troubles psychiques), on arrive à mettre des mots sur les inquiétudes des enfants et à leur faire prendre conscience qu’elles sont partagées par d’autres jeunes. À l’UNAFAM, j’ai également créé une consultation d’accompagnement parental pour que les parents vivant avec des troubles puissent poser leurs questions, au moment où elles surgissent. Car être parent est de toute façon un apprentissage permanent, qu’on soit malade ou non. Et je crois qu’il faut replacer l’enfant dans son âge en aidant les parents à reprendre leur place. Il manque un maillon à la chaîne pour que le sujet soit considéré et financé dans l’organisation du système de santé.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.