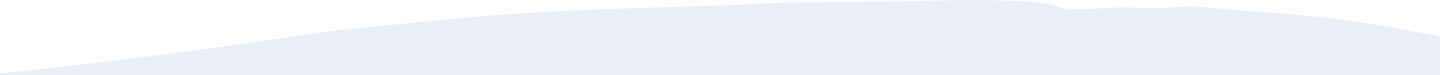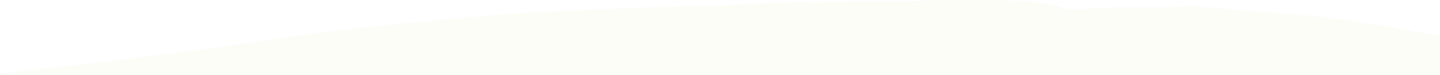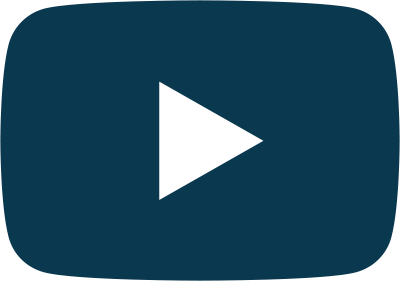« Comment j’ai dévoilé ma maladie à mes proches »
Vivre avec un trouble psychique ne se résume pas aux symptômes ou aux traitements. Lorsqu’un diagnostic est posé et intégré, l’une des étapes les plus décisives et parfois les plus délicates, c’est le moment où l’on choisit d’en parler à ses proches, de se dévoiler. Comment trouver les mots justes ? Comment affronter les peurs, les tabous, les idées reçues ? Entre désir d’être compris, besoin d’alléger le poids du secret et crainte du rejet, le dévoilement devient un tournant intime et fondateur. Plein Espoir a donné la parole à Tonatiuh, Elise, Cathy et Sophie, pour nous raconter comment le dévoilement peut devenir une force, un chemin vers plus de confiance et de liens.
« Se dévoiler, c’était enfin accepter »
Je m’appelle Elise, j’ai 33 ans et je suis pair-aidante professionnelle depuis quatre ans. C’est un métier encore jeune, nous faisons partie des équipes de soins, avec notre expérience vécue. Avant d’en arriver là, il m’a fallu un long chemin, fait de silence, de peur et de dévoilements parfois maladroits. J’ai grandi dans une famille d’artistes, aimante mais où l’on ne parlait jamais de santé mentale, sinon de manière très stigmatisante. Dès l’enfance, j’ai souffert d’angoisses, de TOCs, d’un trouble anxieux qui s’est aggravé à l’adolescence. Je vivais des moments de déconnexion du réel, terrifiants, mais que je taisais. Dans ma famille, mes souffrances étaient minimisées, on me traitait de « drama », on se moquait. Cela m’a enfermée dans l’idée que je n’étais pas légitime à souffrir.
C’est au lycée que les premières grandes dépressions sont apparues. Mes parents voyaient bien que je n’allais pas en cours, que je passais d’états très bas à une exaltation extrême. Mais dans leur univers, avoir un « grain de folie » semblait presque valorisé. Le diagnostic n’est arrivé que plus tard, après des années d’errance. Le dévoilement à ma famille a été beaucoup plus compliqué. Quand le mot « bipolaire » a été posé, mes proches ont réagi avec déni ou peur. Certains m’ont dit d’arrêter les médicaments et de ne pas me fier au psychiatre. Ma mère, surtout, n’a pas su accueillir ma parole. Je m’attendais à du soutien, j’ai rencontré du déni. Mon père, scientifique, a mis plus de temps, mais il a fini par s’informer, comprendre et dialoguer avec moi. Aujourd’hui, il me demande comment je vais, il s’intéresse à ma fille, il a trouvé ses propres repères pour accepter.
Avec le temps, j’ai appris que le dévoilement n’est pas un acte anodin. J’ai beaucoup travaillé sur la façon de le faire, pour moi et pour les personnes que j’accompagne. Évaluer à qui l’on parle, choisir le moment, adapter les mots, inviter à la discussion. Le faire quand on en ressent le besoin, et seulement à ce moment-là. Parce que se dévoiler, ce n’est pas une obligation : c’est un choix. Avec mes enfants, par exemple, j’ai expliqué simplement, avec des livres ou des images, que mes médicaments « nourrissaient mon cerveau » pour qu’il fonctionne mieux. Au travail aussi, j’ai fini par dire la vérité, plutôt que de m’enliser dans des excuses. J’ai découvert que, même si certaines réactions peuvent blesser, la sincérité soulage toujours. Aujourd’hui, je ne cherche plus la validation de mes parents, ni de quiconque. Je sais que ma souffrance est réelle, que mon parcours est légitime. Et je vois, dans mon rôle de pair-aidante, à quel point l’incompréhension familiale peut être un facteur de rechute. C’est pourquoi j’insiste, réussir son dévoilement, c’est déjà poser une pierre sur le chemin du rétablissement.
« Briser le tabou »
Je m’appelle Cathy, j’ai grandi dans une famille où la psychiatrie était présente, mais entourée de silence. Mon père était maniaco-dépressif, comme on disait alors, mais à la maison on ne prononçait jamais ces mots. On parlait vaguement de « soucis de santé », et ma grand-mère ne voulait surtout pas que cela se sache. J’ai grandi dans ce climat de non-dit et de tabou.
Adulte, ce fut mon tour. J’ai traversé ce que l’on appellerait aujourd’hui un burn-out, suivi de longues années de dépressions. On me soignait avec des antidépresseurs, sans penser à la bipolarité. Jusqu’au jour où une phase maniaque est arrivée. Mon conjoint, déstabilisé, a eu la présence d’esprit de me filmer. Les images ont parlé d’elles-mêmes : mon psychiatre a enfin posé le diagnostic. Au début, je n’y ai pas cru. Moi, bipolaire ? J’ai traversé le déni, cherché d’autres explications, refusé l’évidence. Même ma mère ne voulait pas que l’histoire se répète. Mais peu à peu, j’ai compris qu’un diagnostic était une chance qui signifiait d’être soignée avec les bons médicaments. Et surtout, de pouvoir sortir du flou.
Avec mes proches, le dévoilement s’est fait assez tôt, parce qu’il fallait comprendre ce qui m’arrivait. Mais ce n’était pas simple, chacun avait ses peurs, ses résistances. Ce qui m’a aidée à franchir une étape, c’est l’écriture. Mon psychiatre m’en parlait depuis longtemps, et un jour j’ai osé. Mettre ma vie sur le papier, sans fard. J’ai publié ce livre (La petite fille au sourire figé), pour moi mais aussi pour les autres. Certains proches ont découvert mon histoire en le lisant. C’était une façon de dire les choses sans avoir à répéter, et surtout de transformer ma souffrance en quelque chose d’utile. Ce livre m’a donné la mission de contribuer à libérer la parole, briser le tabou qui a enfermé mon père, et montrer qu’il n’y a pas de honte à vivre avec un trouble psychique. J’ai reçu de nombreux retours de lecteurs, certains y ont trouvé des repères, d’autres de l’apaisement. Moi, j’y ai trouvé du sens. Cela fait deux ans que je vais bien. Les médicaments m’aident, mais avoir une vie qui donne envie, une parole assumée, ça change tout.
Avec mes enfants, j’ai aussi choisi la vérité, adaptée à leur âge. Petits, on parlait d’une « maison pour se reposer » à la place de l'hôpital. Aujourd’hui, adolescents, ils lisent certains passages du livre avec moi. C’est parfois dur, mais au moins les choses sont dites. Je préfère ça au silence que j’ai connu enfant, où l’absence de mots me laissait imaginer le pire. Dire les choses m’a soulagée. Je ne suis pas qu’une maladie, ni qu’un diagnostic. Je suis une femme, une mère, une autrice, une personne qui avance. Et si mon histoire peut aider à déstigmatiser, alors c’est là ma manière de transformer une épreuve en force.
« Les bons mots pour en parler »
Je m’appelle Tonatiuh, j’ai 31 ans, et cela fait sept ans que je suis suivi en psychiatrie. Au départ, les médecins pensaient que j’étais simplement quelqu’un de très déprimé. J’ai été traité aux antidépresseurs, sans vraiment questionner davantage. Mais avec le temps, le diagnostic a évolué. Ce n’était pas une surprise totale, ma grand-mère était bipolaire, et je savais que ce facteur génétique pouvait jouer.
Au travail, j’ai toujours été très transparent sur ma pathologie, pour éviter les malentendus. Je préfère que mes collègues comprennent que mes réactions sont liées à ma maladie, plutôt que d’imaginer que je suis instable ou capricieux. Avec mes parents, en revanche, ça a longtemps été plus compliqué. Sans doute parce que j’avais envie de les protéger, surtout ma mère, et parce que leur regard comptait différemment. C’est au moment de mes premiers traitements que j’ai décidé d’en parler à mes parents. Mon père n’a pas été bouleversé, il connaissait déjà de près la maladie. Ma mère, en revanche, a réagi par la peur : « Il faut que tu arrêtes tout de suite ! » Elle avait en tête beaucoup d’idées reçues, elle ne savait pas exactement ce que ça signifiait. J’ai dû faire un travail de pédagogie auprès d’elle, lui expliquer que non, ce n’était pas une condamnation, mais simplement la nécessité d’avoir un traitement adapté.
J’avais 25 ans à ce moment-là. Mais le vrai dévoilement, celui où j’ai nommé la bipolarité, est venu beaucoup plus tard, il y a seulement six mois. J’ai attendu le bon moment, le bon mot, la bonne façon de le dire. Quand j’ai trouvé un traitement stabilisateur qui me convenait enfin, et que j’ai constaté ses effets positifs dans ma vie, j’ai senti que je pouvais en parler plus sereinement. J’ai commencé par mon père, puis, ensemble, nous avons préparé le terrain avec ma mère. Nous avons eu une vraie discussion, autour d’un verre, où j’ai expliqué simplement : « Ce traitement, il me fait du bien. Il m’aide à mieux contrôler mes humeurs, à avoir une vie plus stable, plus heureuse. » Leurs réactions ont changé. D’abord de la curiosité, des questions dans tous les sens, puis une écoute bienveillante. Ce moment a marqué une bascule, au lieu de cacher, j’ai pu partager. Depuis, il y a plus de confiance entre nous. Mes parents me posent parfois des questions concrètes sur mon suivi, mon psychiatre, mon ressenti. Ça ne se limite plus à un vague « Comment ça va ? », mais à un vrai échange.
Aujourd’hui, je vois le dévoilement comme un acte de confiance. Quand j’en parle, c’est avec des personnes en qui j’ai foi, ou parce que je veux construire cette confiance avec elles. C’est une vulnérabilité assumée. Et je crois que c’est ça qui a changé. Je n’ai plus besoin de prendre mille précautions, d’hésiter pendant des mois avant d’aborder le sujet. Je peux enfin être spontané, et c’est un soulagement.
« En couple, je savais qu’il faudrait le dire »
Je m’appelle Sophie, j’ai 26 ans et mes troubles ont commencé au lycée, puis se sont aggravés après une relation violente. Quand j’ai enfin quitté cet homme, j’ai sombré dans une dépression sévère, ponctuée de plusieurs hospitalisations. On parlait de stress post-traumatique, de mal-être ancien, mais rien n’était encore clairement nommé.
En 2023, lors d’un épisode hypomaniaque, le diagnostic est tombé : trouble bipolaire. Ce n’était pas un choc total, car un psychiatre m’avait déjà prévenu que c’était possible, vu mes réactions aux antidépresseurs. Mais le jour où ma psychiatre a posé les mots, j’ai pleuré dans la rue. J’ai mis du temps avant de rentrer chez moi. Puis je suis allée voir mes parents et je leur ai dit. Ils s’en doutaient. Ils m’avaient vue passer par toutes ces phases, ils savaient. Ma mère a pleuré, mon père a été pragmatique. Ils m’ont dit que ce n’était pas grave, que c’était une maladie comme une autre, un déséquilibre dans le cerveau. Avec les antécédents familiaux, ce n’était pas une surprise. Pour moi, les prévenir, c’était aussi une manière de me protéger, qu’ils sachent, au cas où je dérape, qu’ils puissent réagir et m’encourager à appeler ma psychiatre. J’ai ensuite choisi de le dire à ma sœur, puis à deux amis très proches. Mais il m’a fallu un an avant de franchir le pas. J’avais peur d’être jugée, peur qu’on me considère comme instable. En réalité, mes amis ont été bienveillants. Ça m’a rappelé que la plupart des préjugés viennent de l’extérieur, dans les films, les journaux, qui associent la bipolarité à la violence ou à la dangerosité.
Dans ma vie amoureuse, j’ai choisi la transparence. Quand je me suis mise en couple après le diagnostic, je savais qu’il faudrait le dire. On allait habiter ensemble, il me verrait prendre mes médicaments. Je ne pouvais pas garder ça secret. Mais je voulais bien choisir mes mots. Je me suis dit : un diabétique n’a pas besoin de “faire son coming out”. C’est juste une maladie, il prend son insuline, c’est normal. J’ai voulu considérer ma bipolarité de la même façon. Alors, au détour d’une conversation, je lui ai dit “je suis bipolaire”. Il m’a demandé ce que ça voulait dire. Je lui ai expliqué, et ça s’est bien passé, il a été là pour moi.
Au travail, je n’en parle pas. Dans l’Éducation nationale, ce n’est pas un milieu que je trouve sécurisant et plutôt performatif. J’ai peur que mes collègues me voient autrement, ou que les parents d’élèves l’apprennent. Alors je garde le silence. Le plus difficile reste ma famille à La Réunion. Certains pensent que mes troubles sont liés à la sorcellerie. J’ai même été exorcisée dans une église évangélique. Un jour, lors d’un repas, j’ai fait une crise de panique. Mes oncles, pourtant enseignants, ont dit que j’étais « possédée ». Ces moments sont douloureux et absurdes à la fois. Ils rappellent que se dévoiler n’est pas toujours entendu comme on l’espérait. Mais dans l’ensemble, j’ai eu de la chance car mes proches les plus importants ont accueilli ma parole. Et c’est l’essentiel. Parce que dire, ce n’est pas seulement informer, c’est aussi se protéger, sortir du secret, et trouver un appui.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.