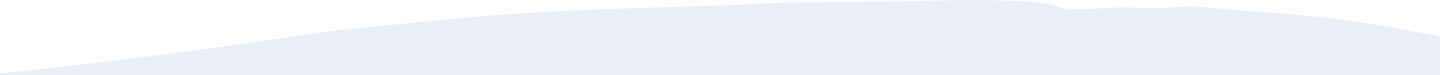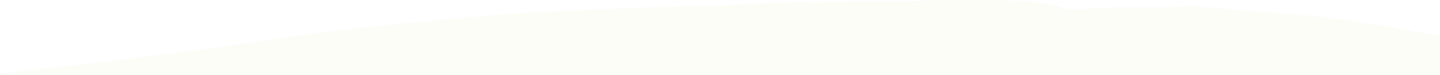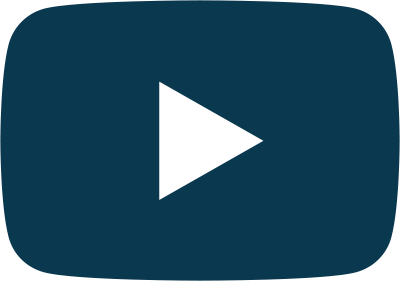Des musées pour toutes et tous : inclusion et santé mentale
Aller au musée peut paraître simple pour certains. Mais franchir les portes d’un lieu culturel peut parfois intimider. La peur du regard des autres, l’inconnu, l’ambiance silencieuse, les règles implicites, tout cela peut décourager, voire angoisser. Pour remédier à cela, à Paris, le musée Carnavalet et l’Institut du monde arabe inventent des façons nouvelles d’accueillir. Des visites pensées pour être plus inclusives, des ateliers pour créer, des espaces pour respirer… et surtout, des lieux où tout le monde peut se sentir à sa place.
Des projets pensés pour inclure
Au musée Carnavalet, dans le Marais à Paris, il y a bien plus que des tableaux ou des souvenirs du passé de la ville. Il y a aussi des espaces de création, des moments de partage, des lieux de reconnexion. Depuis novembre 2022, l’établissement a mis en place un programme d’art-thérapie destiné à des publics vulnérables, notamment ceux en souffrance psychique ou vivant avec un handicap psychique. Maxime Boulegroun-Ruyssen, responsable de projets accessibilité à l'attention des publics vulnérables au sens large nous en parle avec enthousiasme : « Ce programme, on le construit avec des partenaires médico-sociaux (CHU Sainte-Anne ou le GHU Paris), et sous le mécénat d’Entreprendre pour Aider (Un fond de dotation qui soutient les projets en faveur de la santé mentale, ndlr). Il s’adresse à des jeunes, des adultes, des personnes âgées et il permet de créer du lien, de se sentir à sa place, de découvrir le musée autrement. » Le programme s’articule en trois volets : des cycles d’art-thérapie avec des partenaires associatifs ou des structures d’accompagnement ; une programmation événementielle, avec un week-end bien être une fois par an ; un axe formation du personnel d'accueil des publics.
Au cœur de l’histoire, des espaces pour respirer
Entre 2016 et 2021, le musée a été entièrement rénové, l’occasion d’une réflexion globale sur l’accessibilité. Les parcours ont été repensés ainsi que les dispositifs d’aide à la visite, avec l'envie affirmée de devenir un lieu d’inclusion. « On a souhaité que chacun·e puisse se reconnaître dans le musée. En incluant le plus possible tous les visiteurs, quelle que soit leur situation, leurs origines, leur âge, leurs envies et leurs besoins éventuels. », insiste Noémie Giard, responsable du service des publics.
Le musée, un lieu propice à l’art-thérapie
Le musée Carnavalet, dédié à l’histoire de Paris, offre un cadre particulièrement adapté à l’art-thérapie. À travers ses collections mêlant œuvres d’art, objets du quotidien, maquettes, photographies ou encore affiches anciennes, il permet de tisser des liens sensibles entre passé et présent. « Beaucoup d’objets racontent le début de Paris ou la vie quotidienne », explique Maxime Boulegroun-Ruyssen. Cette richesse visuelle et émotionnelle favorise l’émergence de souvenirs personnels et d’émotions, autant de leviers puissants pour les séances d’art-thérapie.
Construit sur la durée, chaque cycle peut compter jusqu’à douze séances. « On essaie de proposer un nombre de séances suffisamment conséquent pour que le public puisse développer une familiarité et un lien assez fort avec le musée », explique Maxime Boulegroun-Ruyssen. L’objectif est clair, faire du musée un lieu de reconnexion, de créativité, mais aussi de bien-être.
Chaque séance suit un déroulé ritualisé : accueil, observation d’une œuvre, atelier de création, puis un temps de partage. Les techniques varient, de la peinture au pastel en passant par le modelage, l’écriture ou encore le travail du corps. L’encadrement est assuré par deux art-thérapeutes professionnelles, Sonia Dupont Bonnamour et Stefania Tsakiraki.
Les œuvres choisies dans les collections résonnent souvent avec les vécus des participant·es. Un groupe de jeunes hospitalisé·es a ainsi travaillé sur le thème des transformations de la ville en miroir des transformations de l’adolescence. Les anciennes enseignes de commerce ou la pendule Tour Eiffel suscitent aussi de fortes projections : « Elles sont à la fois concrètes et ouvertes à l’imaginaire. Une enseigne en forme de cerf, par exemple, peut évoquer la résilience ou l’élan vital », commente la responsable de projet accessibilité.
Au-delà des chiffres, 286 participant·es (personnes concernées plus accompagnants) directs en deux ans, plus de 100 séances prévues en 2025, les effets qualitatifs sont très marqués. Estime de soi renforcée, curiosité retrouvée, désir de retour au musée, lien social réactivé. « Beaucoup nous disent qu’avant, ils n’osaient pas mettre les pieds dans un musée. Aujourd’hui, ils s’y sentent chez eux ».
Et cette volonté d’inclure se ressent jusque dans la façon dont sont accueillis les groupes : pas de fermeture du musée, mais des arrivées en avance pour éviter l’affluence et préparer les séances, une attention aux agents de salle pour qu’ils soient bienveillants, une cohabitation respectueuse avec les autres visiteurs. Un musée qui s’ouvre vraiment. Ancré dans la réalité des besoins, ce programme témoigne d’une conviction forte que la culture peut être un soin. Et le musée, un espace de mieux-être partagé.
À l’Institut du monde arabe, une approche sensible et engagée
À quelques stations de métro de là, l’Institut du monde arabe (IMA) mène aussi une politique d’inclusion forte. Depuis plusieurs années, l’Institut du monde arabe (IMA) développe une politique d’accessibilité portée par un binôme engagé : Clémentine Lohrër, chargée de médiation, et Marie Moënne, chargée d’accessibilité et de handicap. Ensemble, elles forment ce qu’elles appellent le « pôle accessibilité » de l’institution. Et depuis 2025, l’IMA a mis en place un projet spécifique. « Nous avons démarré un programme avec des mineur·es non accompagné·es, en partenariat avec l’Aide sociale à l’enfance. Ce sont souvent des jeunes isolé·es, parfois en situation de grande vulnérabilité psychique. L’idée, c’est de les accueillir régulièrement (une fois par mois) et sur le long terme (3 ans) pour des ateliers artistiques, sensoriels, et des visites construites sur mesure. »
Leur démarche repose sur une conviction forte, accueillir tous les publics dans leur diversité, en prêtant une attention particulière aux personnes en situation de handicap ou en souffrance psychique. « Il s’agit d’être sensible à toutes les personnes qui constituent la société », résume Clémentine Lohrër. L’IMA collabore avec le SEmNA (Service d'Éducation de l'enfant malade ou en difficulté) autour de ce programme. Il réunit les équipes culturelles, les éducateurs spécialisés et les professionnels de santé (avec la présence de Fatima Touy, psychologue clinicienne) et propose des ateliers à la carte, centrés sur la création artistique comme levier de valorisation et de reprise de confiance. Un fil conducteur autour de la musique, pensée comme langage universel, sert de point d’ancrage à ces rencontres. L’objectif est de permettre aux participant·es de sortir des situations d’échec, de retrouver estime de soi, fierté individuelle et sentiment d’appartenance au groupe, à travers le geste, le mouvement ou l’expression plastique. Quatre grands axes guident ces rencontres. Valoriser leur langue maternelle, stimuler leur expression artistique, favoriser la cohésion du groupe et réveiller leurs sens souvent anesthésiés par des parcours migratoires complexes. L’IMA se positionne clairement comme un « lieu ressource », un espace d’accueil, de répit et de reconnexion.
À côté de ce programme, L’IMA expérimente également d’autres formes d’approche sensible, comme les « slow visits », menées notamment par Marie Moënne chargée de médiation, avec la sophrologue Gaëlle Piton. Ces visites lentes, conçues comme des « moments de respiration », permettent aux publics en souffrance ou en fragilité de s’approprier les lieux culturels à leur rythme. « Ce sont des dispositifs très bien reçus », souligne Clémentine. Pour les équipes de l’IMA, ces projets ne relèvent pas de la marge mais incarnent une vision du musée comme espace profondément humain, ouvert à toutes les sensibilités. « C’est une thématique qui touche absolument tout le monde », conclut Clémentine Lohrër.
Des barrières invisibles mais bien réelles
Pour beaucoup de personnes concernées par un trouble psychique ou leurs familles, l’idée même d’entrer dans un musée peut générer de l’anxiété. Inconnu, ambiance feutrée, peur de mal faire ou d’être jugé·e… Ce qui freine, ce n’est pas seulement la maladie ou la fatigue. Ce sont aussi les règles implicites, les codes culturels non dits, la crainte d’enfreindre sans le savoir. « Face à un musée, beaucoup de personnes vivant avec un handicap psychique ou un vécu traumatique, peuvent redouter de ne pas en comprendre les règles. Plus un lieu paraît strict, plus la peur d’être jugé·e est forte. On craint de faire un geste de travers, d’être regardé·e de travers. Et alors… on n’y va pas », explique Maxime Boulegroun-Ruyssen.
Cela vaut aussi pour les proches, les familles. Certaines préfèrent ne pas risquer une sortie culturelle si leur enfant est susceptible de faire une crise ou de s’exprimer bruyamment. « Au sport, c’est plus accepté. Courir, crier… c’est normal. Mais dans un musée ? On se dit qu’on va déranger, qu’on va être dévisagé·e. » D’où l’importance de normaliser la présence de tous les publics dans ces lieux. « Ce sont des questions complexes, mais essentielles. Nous avons beaucoup travaillé avec les équipes de surveillance du musée pour qu’elles soient attentives, bienveillantes, notamment envers les groupes accompagnés par des thérapeutes. Et ce climat d’attention finit par bénéficier à tous les visiteurs. » Et puis, il y a un autre inconnu : les visages. « Quand on ne connaît personne, on ne sait pas à qui s’adresser. On a peur de mal tomber. De ne pas être compris·e, ou accueilli·e. »
Alors le musée Carnavalet s’interroge. Comment rendre les agents plus facilement identifiables comme des personnes ressources bienveillantes ? « Nous, on sait qu’ils sont accueillants. Mais les publics, eux, ne le savent pas toujours. » Redonner confiance, c’est aussi cela. Rassurer dès l’entrée, dès le premier regard.
Pour déverrouiller ces obstacles, les projets des musées s’appuient sur des liens solides avec le secteur médico-social. « Ce n’est pas juste une visite. C’est une démarche dans la durée, avec une montée progressive en confiance. Les participant·es ne viennent pas juste voir des œuvres, ils les vivent », explique Maxime Boulegroun-Ruyssen. Les groupes sont encadrés, les séances ritualisées, et les participant·es savent à quoi s’attendre. Chaque atelier suit une trame rassurante.
Au-delà des œuvres, c’est la possibilité d’être accueilli·e tel·le que l’on est qui fait la différence. À l’IMA, Clémentine Löhrer insiste sur cette idée : « On ne soigne pas, mais on accueille. Et on crée des conditions pour que les jeunes se sentent valorisé·es, entendu·es. »
Et demain ? Des musées toujours plus ouverts
Ces projets ne sont pas des expérimentations isolées. Ils s’inscrivent dans une volonté plus large de transformation des pratiques muséales. Carnavalet travaille actuellement à la création d’un guide « Musée et Santé mentale », en partenariat avec le collectif Les Issus. Ce guide réunira les apports de personnes concernées, de professionnel·les de la santé mentale, de la culture et de la recherche. « Il y a encore trop de barrières invisibles dans les musées. Ce guide, c’est une manière de les identifier, et surtout de proposer des solutions concrètes », précise Maxime Boulegroun-Ruyssen. L’enjeu est aussi de professionnaliser les équipes. Sensibiliser les agents d’accueil, former les médiateur·rices, penser les dispositifs d’accueil autrement.
Un enjeu de société
Inclure les personnes concernées par des troubles psychiques dans la vie culturelle, ce n’est pas une faveur. C’est une nécessité. Clémentine Löhrer le rappelle : « L’année 2025 est celle de la santé mentale. C’est un signal fort. Mais il faut que ça dure, que ça infuse. ». D’autres institutions culturelles commencent à s’emparer activement des enjeux liés à la santé mentale et à l’inclusion. C’est le cas du musée national de la Marine avec son dispositif de « la Bulle », un espace pensé spécifiquement pour accueillir les personnes en situation de trouble du spectre autistique. Autre initiative en pleine expansion, le dispositif Culture Relax, initialement lancé pour rendre la culture accessible à des publics en situation de handicap invisible ou de fragilité psychique. « J’ai vu que l’Opéra de Paris l’avait mis en place récemment, lors d’une représentation de La Belle au bois dormant », souligne Clémentine Löhrer. Il prévoit par exemple un assouplissement des règles en salle (possibilité de sortir, de faire du bruit) et se déploie peu à peu sur tout le territoire, bien au-delà de l’Île-de-France. Ces démarches visent à apaiser l’expérience culturelle et à rassurer des personnes pour qui le musée ou la salle de spectacle peuvent être perçus comme intimidants. Des pratiques encore émergentes, mais qui trouvent progressivement leur place dans les agendas culturels.
Des musées vivants, pour une société vivante
Les initiatives du musée Carnavalet et de l’Institut du monde arabe montrent la voie d’une culture accessible, inclusive. En allant au-delà du simple accueil, en créant des projets sur la durée, en s’alliant avec le soin sans se substituer à lui, ces lieux deviennent des terrains d’exploration. Des lieux où, quand on vit avec un trouble psychique, on peut se sentir à sa place.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.