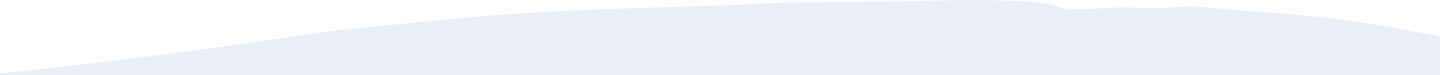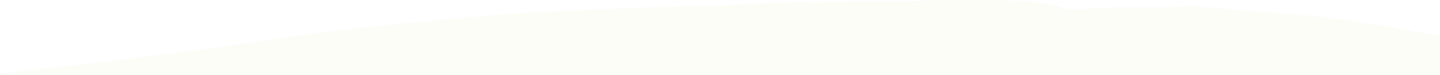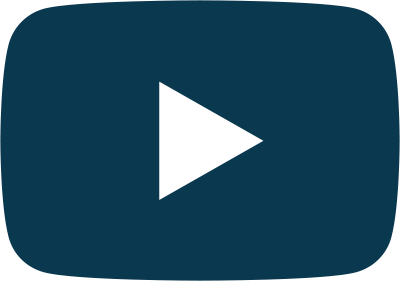« Folie, maladie, schizo… » : quels mots pour parler santé mentale ?
Dire « je suis malade », « je vis avec un trouble », « je suis schizophrène »… Les mots que l’on choisit pour parler de sa santé mentale pèsent lourd. Ils influencent non seulement la manière dont l’entourage réagit, mais aussi la façon dont on s’approprie son propre vécu. Entre peur de stigmatiser, volonté de nommer les choses clairement et besoin de trouver ses propres mots, le dévoilement est un art sémantiquement délicat.
« Je suis malade mental ». C'est avec ces mots, que l'on imagine choisis avec soin, que Nicolas Demorand, journaliste et co-animateur de la matinale de France Inter, a dévoilé son trouble bipolaire, à la radio le 26 mars 2025. Une prise de parole courageuse et directe, saluée par l'opinion dans son ensemble, mais qui soulève plusieurs questions sémantiques importantes. Pour Anne Leroy, la cofondatrice de Positive Minders, une association qui vise à sensibiliser et déstigmatiser les maladies psychiques. « Tous les médias ont repris cette expression en boucle, c'est un peu dommage. Évidemment, chacun choisit les mots qui lui conviennent pour se dévoiler, mais dans ce cas précis, je trouve qu'utiliser les termes de "trouble psychique" ou de "maladie psychiatrique" aurait été plus juste. Car la "maladie mentale" c'est large, ça recouvre aussi les troubles du neurodéveloppement par exemple. »
Si Anne Leroy tatillonne sur ce point, c'est qu'elle connaît les enjeux complexes du vocabulaire en santé mentale. D'un côté, l'expression « malade mental » peut avoir une connotation péjorative et stigmatisante. De l'autre, elle reste plus parlante pour le grand public que des termes comme « troubles psychiques », moins connus mais plus précis médicalement. Un dilemme entre impact médiatique et justesse terminologique.
Cette question de la précision des mots, Anne Leroy l'a vécue dans sa chair lorsqu'elle a accompagné son fils vers un diagnostic. Contrairement à la franchise de Nicolas Demorand, elle se rappelle très bien de la discussion avec le médecin de son fils, qui au moment de poser le diagnostic, avait pris mille détours. Face à cet évitement, elle fut contrainte de prononcer elle-même les mots précis : « mon fils a un trouble schizophrénique, c’est ça ? », ce que le professionnel confirma. Cette réticence du médecin s'explique peut-être en partie par la lourde charge sociale qui pèse sur le mot « schizophrénie ».
Quand les mots effraient
Dans le champ lexical de la psychiatrie, certains termes font plus peur que d’autres, notamment à cause de mauvaises représentations médiatiques. « “Le tueur violent et schizophrène” en est typiquement l’exemple. On l’a vu dans beaucoup de films mais aussi dans le traitement des faits divers par la presse. Des représentations nocives qui pèsent dans l’inconscient collectif et stigmatisent énormément les personnes concernées, elles-mêmes effrayées par ces termes », analyse Anne Leroy.
Des mots parfois utilisés à tort et à travers qui finissent par se vider de leur sens comme les expressions « je suis schizo » ou « je suis bipole », qui circulent dans les cours de récré pour évoquer le moindre changement d'humeur. Poussée à l'extrême, la connotation négative de certains termes conduit parfois à leur bannissement. C'est le cas d'« asile » ou d'« aliéné », qui évoquent les pratiques psychiatriques du passé, aujourd'hui largement décriées. Quand d’autres mots encore utilisés, mériteraient pourtant d’être questionnés selon Anne Leroy. « J’entends encore trop souvent l’expression “il ou elle est interné”. Alors que non, la personne est hospitalisée, avec un cadre, avec des règles, mais elle n’est pas “internée”. » Une réaction justifiée par la charge négative qui pèse sur la notion d'internement.
Le mot « fou » traîne également un lourd passé stigmatisant. Par exemple, l'expression « le fou du bus », beaucoup employée par les jeunes, désigne cette personne au comportement étrange ou perturbant que chacun évite dans les transports en commun, renforçant les préjugés et la peur autour des troubles psychiques. Ce cliché contribue à marginaliser davantage les personnes en souffrance mentale, réduites à des caricatures inquiétantes. La « folie » peut en revanche être douce, joyeuse… portant aussi une dimension positive. « Ne dit-on pas "avoir un grain de folie" ? » rappelle la cofondatrice de Positive Minders. Dans ces mêmes cours de récré, on qualifie d'ailleurs de « fou » tout ce qui relève de l'extraordinaire, réhabilitant, dans le bon sens, cette expression. Cette ambivalence du terme illustre parfaitement la complexité du langage autour de la santé mentale : les mêmes mots peuvent à la fois blesser et célébrer, selon le contexte et l'intention.
Un enjeu sociétal et politique
Au-delà des histoires individuelles, le choix des mots autour de la santé mentale revêt une dimension sociétale et politique majeure. « Le vocabulaire que nous utilisons collectivement façonne notre rapport à ces questions », souligne Anne Leroy. Quand les médias privilégient systématiquement certains termes, quand les politiques publiques adoptent tel ou tel champ lexical, cela influence directement les représentations sociales et, in fine, l'inclusion des personnes concernées. L'évolution du vocabulaire officiel passé des « malades mentaux » aux « personnes en situation de handicap psychique », témoigne de cette transformation progressive des mentalités. Pour autant, la cofondatrice de Positive Minders constate que « tout édulcorer, ne rend pas forcément service ». Un paradoxe qui révèle la complexité de ces enjeux : entre volonté de déstigmatiser et nécessité de nommer clairement les réalités, la société peine encore à trouver le juste équilibre sémantique.
L’appropriation des mots par les personnes concernées
Faut-il dire « je suis schizophrène » ou « je vis avec un trouble schizophrénique » ? Emré, 31 ans, diagnostiqué récemment, raconte la difficulté de s’approprier ces mots. « Moi je ne dis pas, “je suis”, parce que la maladie ne me définit pas », insiste-t-il. Lui a opté pour un dévoilement radical : une vidéo de neuf minutes diffusée sur ses réseaux sociaux, pour expliquer son diagnostic et son quotidien. Une prise de parole qui a suscité des soutiens inattendus : des amis, d’anciens camarades de classe, des proches de personnes concernées… « Cela m’a montré que je n’étais pas seul », confie-t-il.
Mais chacun avance à son rythme. Pour certains, dire « je suis schizophrène » est une manière assumée de se réapproprier un terme trop longtemps utilisé contre eux. Pour d’autres, il reste préférable d’utiliser des formulations plus neutres. « Seule la personne concernée peut choisir les mots avec lesquels elle se sent à l’aise », rappelle Anne Leroy.
Trouver la bonne oreille
Mais ce n'est jamais simple. « Face à un employeur, à un amoureux, à des proches, on n'a aucune idée de la réaction que cela va susciter », analyse la cofondatrice de Positive Minders. Une chose est sûre : le silence peut blesser encore davantage que la parole. L'association a ainsi accompagné une famille où une sœur et sa mère se déchiraient sur cette question. La première souffrait d'entendre son frère atteint d'un trouble psychique se faire dénigrer par les autres membres de leur famille qui ne comprenaient plus son comportement, tandis que la seconde refusait de révéler quoi que ce soit sur l'état de santé mental de son fils. « Quand ce dernier a pu enfin trouver les mots pour partager son diagnostic avec son entourage, la relation mère-fille s'est apaisée », raconte-t-elle.
Ainsi, se dévoiler ne dépend pas seulement des mots employés, mais aussi de la qualité de l'écoute. Dans la famille, dans le couple, au travail, l'essentiel est de créer un espace sûr où les peurs, les doutes et les besoins peuvent être partagés. « La manière compte autant que le contenu », résume Anne Leroy. Aux proches, elle recommande d'accueillir l'annonce avec bienveillance, sans la minimiser ni la dramatiser. Surtout, de se renseigner sur ce que vit réellement la personne. Aux employeurs, cette ancienne RH devenue cofondatrice d'association, conseille de savoir tendre une « perche » pour aider à libérer la parole des salariés et des candidats à l'emploi. En sachant que tout est affaire de contexte et d'équilibre : nommer clairement les choses, mais avec tact, en choisissant un vocabulaire qui respecte l'expérience sans alimenter les clichés.
En matière de dévoilement, une chose est sûre : il n'existe pas de « bons » ou de « mauvais » mots. L'essentiel est que chacun puisse choisir les siens, dans un cadre où ils seront entendus sans jugement. Chez Plein Espoir on sait combien pour les personnes concernées, réussir à mettre des mots sur son trouble psychique, est un pas de géant pour avancer sur le chemin du rétablissement.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.