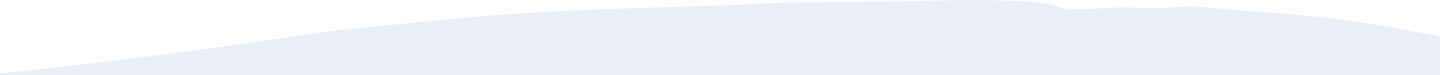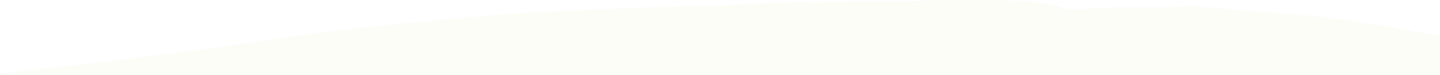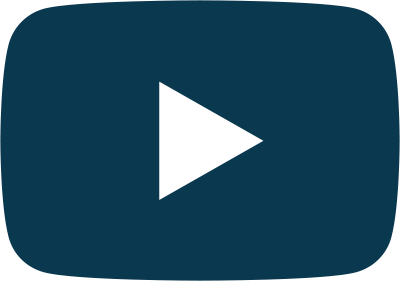Santé mentale : soigner c’est considérer la culture de chacun
Quand la psychiatrie rencontre l'anthropologie pour mieux accompagner les personnes en souffrance psychique issues de la migration, une approche révolutionnaire prend forme : l'ethnopsychiatrie. Cette discipline reconnaît que la culture d'origine façonne profondément notre manière d'exprimer et de comprendre nos troubles psychiques. Et cette reconnaissance change tout : elle ouvre des portes là où les approches traditionnelles butaient sur des silences.
Pour illustrer l'ethnopsychiatrie, Nathalie Zajde, psychologue et maître de conférence à l'université Paris-VIII, raconte dans l'émission Zoom Zoom Zen sur France Inter, le cas d'une femme marocaine arrivée à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Le psychiatre qui l'accompagne la décrit alors comme étant « déprimée ». On lui donne des médicaments, on tente une psychanalyse, une psychothérapie, mais rien ne fonctionne. On observe qu'elle reste mutique et ne répond à aucun traitement classique.
Mais tout change quand un psychologue marocain de l'équipe lui parle dans sa langue, en arabe marocain. Petit à petit, elle confie alors ce qu'elle n'osait pas dire en français : elle a été ensorcelée par sa belle-mère. « Elle ne se sentait pas de le dire avant parce que ce ne sont pas dans nos codes ! Elle avait peur qu'on la prenne pour une folle », explique Nathalie Zajde. « La parole s'étant enfin libérée pour cette patiente, il a ensuite été possible de chercher les façons de la soigner », poursuit la spécialiste. Un déblocage porteur d'espoir : quand on trouve les bons mots, dans la bonne langue, le soin redevient possible.
Ce cas clinique illustre parfaitement ce qu'est l'ethnopsychiatrie : une approche qui reconnaît que de nombreuses personnes en situation d'exil portent des explications culturelles de leur mal-être qu'ils ne peuvent exprimer dans un cadre occidental classique, par peur d'être stigmatisés. L'ethnopsychiatrie leur redonne alors une voix.
La discipline est née dans les années 1970, à l'initiative du psychologue Toby Nathan, qui face à des personnes venues d'ailleurs dont les troubles résistaient aux approches psychiatriques dominantes, a dû repenser leur prise en charge. L'ethnopsychiatrie repose sur un principe : « L'étude des manières qu'ont les peuples de soigner les personnes en souffrance psychique », précise Nathalie Zajde. Le terme décompose cette ambition avec "ethno" pour peuple et "psychiatrie" pour le soin de l'âme.
Quand les cultures redéfinissent la souffrance psychique
L'histoire commence bien avant, avec le psychanalyste Georges Devereux, né en 1908 en Roumanie, polyglotte et anthropologue. Dans les années 1940, il part vivre chez les Indiens Mohaves en Arizona. Il y découvre une réalité troublante : les troubles psychiques ne se définissent pas de la même manière selon les cultures.
Les Mohaves connaissent "la folie du scalpeur" : un guerrier qui, après avoir tué un ennemi, devient terne, ne parle plus. « Il y a un esprit qui se saisit du Mohave et prend possession de lui », raconte Nathalie Zajde. Avec notre vision occidentale, on parlerait de stress post-traumatique. Mais le traitement est radicalement différent : la chamane ingère des substances hallucinogènes, part « combattre l'esprit », le soumet et le ramène dans sa sacoche.
De cette immersion ethnographique, Devereux tire une observation capitale qui fondera l'ethnopsychiatrie : si les cultures définissent différemment les troubles psychiques, elles proposent aussi leurs propres solutions thérapeutiques, tout aussi valides que la psychiatrie occidentale. Cette révélation bouleverse la conception universaliste de la maladie mentale et pose les bases d'une approche qui reconnaît la légitimité des savoirs thérapeutiques de chaque culture. Une révolution en soi : admettre qu'il existe mille façons de guérir, aussi légitimes les unes que les autres.
De la théorie à la pratique : inventer de nouveaux espaces de soin
Disciple de Devereux, Toby Nathan va transformer cette théorie en dispositif clinique révolutionnaire. Né au Caire en 1948, exilé en 1957, il connaît lui-même l'arrachement culturel. En 1979, il franchit un pas décisif : il crée la première consultation d'ethnopsychiatrie à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Son innovation ? Dans le groupe de thérapeutes, il y a toujours quelqu'un qui connaît la culture d'origine de la personne accompagnée. Les consultations sont bilingues, durent deux à trois heures, et réunissent une dizaine de professionnels autour d'une famille.
En 1993, il pérennise cette approche en fondant le Centre Georges-Devereux à Paris, devenu le laboratoire de référence de l'ethnopsychiatrie en France. Les consultations gratuites mobilisent psychologues, médecins, anthropologues et linguistes. Le dispositif est enthousiasmant : il bouleverse radicalement la répartition habituelle des savoirs : les thérapeutes se mettent en position d'apprentissage, reconnaissant que les populations qu'ils accompagnent sont savantes, porteuses de pensées et de pratiques thérapeutiques qu'ils connaissent moins bien qu'elles. Cette posture inverse la logique classique où seul le médecin détient le savoir. On retrouve là un principe cher au rétablissement : reconnaître chaque personne non pas comme un "malade" passif, mais comme un être riche de sa propre histoire et de ses ressources. La personne n'est plus réduite à ses symptômes : elle est pleinement reconnue dans toute sa complexité culturelle et humaine. Une approche qui redonne leur dignité aux personnes accompagnées.
En dé-zoomant, cela pose la question de l'universalité de la psychiatrie, une question vite balayée par la disciple de Tobie Nathan, Nathalie Zajde : « Au même titre qu'il n'existe pas un homme universel qui pense d'une façon universelle, qu'il n'y a pas de langue universelle, il n'y a pas de psychologie universelle ! », affirme l'universitaire au micro de France Inter. Ainsi, sans nier la schizophrénie ou la bipolarité, l'ethnopsychiatrie suggère que ces troubles s'expriment différemment selon les contextes culturels et peuvent coexister avec d'autres interprétations (comme la possession ou l'ensorcellement), qui ont leur cohérence propre dans d'autres cultures. « Au fond, un psychiatre et un désensorceleur berrichon font le même métier, résume Nathalie Zajde. Ils soignent chacun selon sa pratique. Mais ce sont des confrères. »
Quand le silence étouffe : libérer la parole sur la maladie mentale
Le silence autour de la maladie mentale traverse les cultures et les familles. Richard, 30 ans, en a fait la douloureuse expérience. Pendant toute son enfance, face aux crises violentes de sa mère, « dans ma famille, on ne parlait pas de maladie mentale. On disait juste qu'elle avait un "caractère de feu" », raconte-t-il dans un témoignage pour Plein Espoir. « Comme elle venait des îles Fidji, il y avait aussi ce discours un peu racisé, un peu commode : "Elle est comme ça, c'est son tempérament". Chez nous, la folie n'existait pas. C'était impensable, presque honteux. Et d'où elle vient, on dit qu'une personne "folle" a offensé une divinité. Ça jette une ombre sur toute la famille. Alors on tait, on dissimule, on s'habitue. » Ce n'est qu'à 27 ans, après des années de souffrance, que Richard a pu faire hospitaliser sa mère et découvrir qu'elle souffrait probablement de schizophrénie. « Pendant des années, on a souffert d'un secret qu'on n'avait jamais osé nommer », confie-t-il.
L'ethnopsychiatrie propose justement une alternative à ce silence : en permettant d'exprimer la souffrance dans sa langue, selon ses codes culturels, et en prenant en compte les représentations propres à chaque culture, y compris celles qui peuvent sembler éloignées de la psychiatrie occidentale.
Si vous vivez une situation similaire...
Vous ressentez que votre culture d'origine influence votre manière d'exprimer ou de comprendre votre souffrance psychique ? Vous avez du mal à trouver les mots en français pour dire ce que vous ressentez ? Sachez que des ressources existent :
• Le Centre Georges-Devereux à Paris propose des consultations d'ethnopsychiatrie gratuites (Tél. : 01 77 32 10 64)
• Les Centres Médico-Psychologiques (CMP) de votre secteur peuvent parfois orienter vers des thérapeutes parlant votre langue
N'hésitez pas à demander un interprète lors de vos consultations : c'est un droit, et cela peut tout changer.
L'ethnopsychiatrie dans les banlieues
Les principes de l'ethnopsychiatrie inspirent aujourd'hui de nouvelles pratiques auprès des jeunes des banlieues françaises. Face au désert médical en santé mentale dans les quartiers prioritaires, le docteur Jean-Oscar Makasso, ethno-psychologue camerounais qui travaille depuis près de vingt-cinq ans avec des familles venues d'ailleurs, a lancé avec l'association Audeo le dispositif « Un psy dans la cité » à Étampes, Étréchy et Dourdan. Une initiative qui fait bouger les lignes !
Son approche transpose les principes de l'ethnopsychiatrie à un nouveau contexte : les jeunes de banlieue qui, bien que nés en France, ont développé leurs propres codes culturels et portent l'héritage des cultures de leurs familles. « Parfois on me dit : je ne savais pas qu'il y avait un psychologue africain. Les jeunes ont gardé l'esprit de leur pays : la psychologie, c'est pour les blancs », témoigne-t-il dans le documentaire « Un psy dans la cité » diffusé sur France Télévisions.
Comme l'ethnopsychiatrie avec les consultations à Bobigny, Jean-Oscar Makasso applique deux principes fondamentaux : aller au contact des personnes directement dans leur milieu plutôt que d'attendre qu'ils viennent au cabinet, et prendre en compte leurs représentations culturelles de la santé mentale. « Un psy ne peut plus rester seul derrière son bureau. Il doit aller vers les autres sur le terrain, comme un urgentiste ou un pompier. », affirme-t-il dans le magazine ASH (Actualités Sociales Hebdomadaires). En France, 15% des 10-20 ans ont besoin de suivi psychologique, mais dans les quartiers précaires, les familles n'en ont pas les moyens.
Vers une psychiatrie plus inclusive
L'ethnopsychiatrie nous rappelle une vérité : la souffrance psychique ne peut être séparée du contexte culturel dans lequel elle émerge. Dans une France diverse, elle offre des outils précieux pour créer des espaces où la parole se libère, où on entend les personnes dans leur langue et leurs codes. Et c'est une vraie révolution en marche : celle d'un soin qui s'adapte aux personnes, et non l'inverse.
Et la pratique s'étend : l'ethnopsychiatrie a essaimé au Québec, en Italie, en Belgique, au Brésil ou encore en Israël avec une promesse simple : ne laisser personne au bord du chemin de la santé mentale, quelle que soit son origine ou sa manière de penser le monde. Un mouvement porteur d'espoir qui prouve qu'un autre rapport au soin est possible : plus humain, plus inclusif, et donc plus respectueux de ce que chacun porte en soi.
Pour aller plus loin :
- Tobie Nathan, La folie des autres, Dunod, 1986
- Film : Jimmy P, Arnaud Desplechin, 2013
- Documentaire : Un psy dans la cité, France Télévisions, 2024