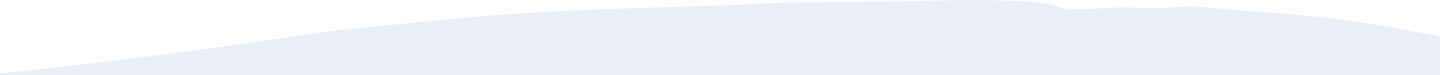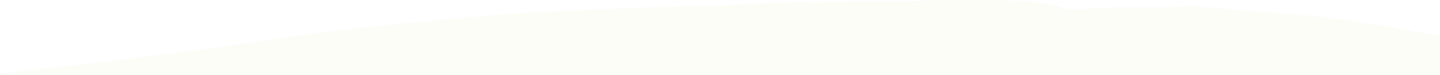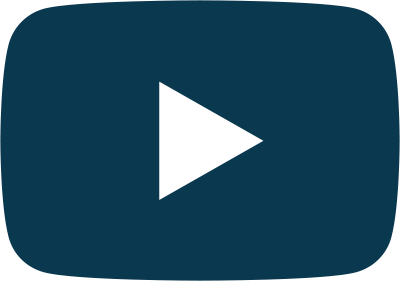Mots et images : comment réécrire l’imaginaire de la santé mentale ?
Folie, psychiatrie, schizophrénie… Ces mots ont traversé les siècles chargés de peurs, de croyances et de symboles qui nous collent encore à la peau. Ils convoquent les sorcières, les tueurs en série, les figures inquiétantes de la littérature, de la peinture et du cinéma. Cet imaginaire continue d’alimenter la stigmatisation et façonne encore notre façon de penser la santé mentale. Pourtant, un autre mot pourrait servir de pivot pour déstigmatiser : le rétablissement. Né dans les années 1970 dans les mouvements d’usagers anglo-saxons, il propose une vision ouverte, évolutive, pour mieux comprendre que l’on peut vivre avec un trouble psychique sans être défini par lui.
Les mots qu’on emploie au quotidien ne sont jamais neutres. Ils portent avec eux un héritage moral, médical, parfois religieux. Ceux de la santé mentale n’y échappent pas. Dire qu’une personne est « folle » ou « hystérique », c’est convoquer les « possédés » des tableaux de la Renaissance, les femmes jugées déviantes dès qu’elles sortaient du cadre, ou encore les pensionnaires d’asile que la littérature décrivait derrière des grilles.
Mais comprendre cet héritage ne suffit plus : il faut maintenant interroger la manière dont ces mots se sont fixés dans nos réflexes sociétaux. Notre culture transporte avec elle des images tenaces, bien loin des réalités contemporaines : la camisole devenue symbole de la déraison, la cellule capitonnée ou encore ces couvertures de magazines des années 1970 où la santé mentale se résume à des visages gribouillés, comme s’il fallait flouter ce qui dérange.
Derrière ces représentations, il y a pourtant des vies bien réelles. Un mot qui réduit, qui caricature ou qui effraie finit toujours par éloigner. Interroger ces images et ce langage, c’est déjà commencer à lever le tabou.
« Folie », un mot qui dit beaucoup de notre rapport à la santé mentale
Dans la santé mentale, aucun mot ne porte une charge aussi lourde que « folie ». Un mot-valise qui réduit tout ce qui déborde : une rupture douloureuse, un militantisme qui dérange, un changement de vie trop soudain pour être compris, un geste qui s’éloigne des normes. Et la pop culture ne fait que renforcer ce réflexe. Au cinéma ou dans les séries, il suffit qu’un personnage déborde — par une émotion trop forte ou une réaction inattendue — pour qu’on le range aussitôt dans la catégorie des « fous ». On l’a vu avec le Joker de Todd Phillips, dont la souffrance se transforme en menace, avec Carrie Mathison dans la série Homeland, dont l’hypersensibilité est souvent prise pour de la confusion, ou encore, avec les héroïnes de films d’horreur trop vite qualifiées d’« hystériques ». Ce mot fonctionne alors comme un raccourci : plutôt que de chercher à comprendre, on préfère s’éloigner et mettre de côté.
Mais d’où vient cette puissance symbolique ? Folie vient du latin follis, le soufflet. « Dans l’Antiquité, on pensait que la folie venait des dieux, et plus particulièrement de Dionysos, raconte la sémiologue Mariette Darrigrand. Il soufflait sur les hommes une énergie chaotique qu’ils ne savaient plus contenir. » On retrouve cette idée dans le mythe du héros habité par une force qui le dépasse. Cette énergie n’est pas un défaut, mais elle est excessive.
Au XVIIᵉ siècle, avec l’évolution des idées et de la médecine naissante, un nouveau mot apparaît : « aliéné ». Il vient du latin alienus, « l’autre », « celui qui n’appartient plus ». Comme l’a montré Michel Foucault dans son ouvrage Histoire de la folie à l’âge classique (éd Plon, 1961), ce changement de vocabulaire dit quelque chose d’essentiel : on ne considère plus la folie comme un trouble passager, mais comme une forme d’éloignement. La personne est vue comme « étrangère » au groupe. Et, parce qu’on la perçoit en dehors, on l’enferme, on la sépare du reste du monde. C’est aussi à cette époque que naissent les images de la camisole de force ou des cellules capitonnées, qui marqueront durablement notre imaginaire. Puis, au XXᵉ siècle, avec Proust et Maupassant, la folie retrouve une part d’humanité. C’est l’époque du poète maudit, du génie tourmenté, mais aussi la matrice d’une mythologie pop : l’artiste incompris, la chanteuse qui s’effondre sous les projecteurs, le créateur flamboyant au bord de la rupture. Une vision romantique qui rappelle que la fragilité fait partie de chacun de nous.
Aujourd’hui, le mot « folie » est pris entre deux mouvements. D’un côté, il continue d’être utilisé pour stigmatiser, disqualifier, ridiculiser. De l’autre, des collectifs comme la Mad Pride ou la Mad Week tentent de le réinventer, de le revendiquer, de dire qu’il peut aussi être un marqueur d’expérience, de lutte, de créativité, une manière de reprendre la main sur un terme qui a longtemps servi à exclure. Comme le rappelle Mariette Darrigrand, « nous vivons dans une époque qui veut normaliser, classifier, diagnostiquer ». Autrement dit : on cherche souvent à tout ranger dans des catégories bien nettes. Et c’est précisément pour cela que ces mouvements de réappropriation comptent. Ils montrent qu’au-delà des diagnostics et des normes, il y a des personnes, des vies, des histoires qui refusent d’être réduites à un mot qui fait peur.
Apprendre à mieux les comprendre, ces termes qui effraient encore
Cette logique de classement crée une hiérarchie invisible entre les mots et, à travers eux, entre les troubles psychiques. Dire qu’on traverse une dépression après un deuil, un burn-out après une charge de travail démesurée, ou qu’on se sent anxieux face à l’état du monde fait désormais partie du langage commun. Ces termes ont gagné droit de cité : ils s’expliquent, se justifient, trouvent leur place dans des récits familiers.
Malheureusement, il n’en va pas de même pour la psychose. Dire « je suis schizophrène » reste presque imprononçable. Le mot déclenche autre chose : la peur, l’inconnu, cette impression diffuse qu’il y a « un seuil » que l’on aurait franchi. La culture populaire renforce souvent ces clichés : le grésillement pour montrer une hallucination, l’écran coupé en deux pour figurer un esprit qui se divise, les personnages inquiétants du film Black Swan, ou de la série Mr. Robot ou de nombreux thrillers où le « fou » est toujours une menace. Là où la dépression appelle la compassion, la psychose reste un territoire fantasmé. « Quand on annonce à des parents que leur enfant est psychotique ou schizophrène, il y a un vertige », raconte Mariette Darrigrand.
Black Swan, ou de la série Mr. Robot ou de nombreux thrillers où le « fou » est toujours une menace. Là où la dépression appelle la compassion, la psychose reste un territoire fantasmé. « Quand on annonce à des parents que leur enfant est psychotique ou schizophrène, il y a un vertige », raconte Mariette Darrigrand.
Il y a aussi le poids des mots eux-mêmes. « Psychose vient de psyché, l’âme. Être psychotique, c’est avoir une rupture d’âme, dit Mariette Darrigrand. Pas étonnant que le mot effraie : il touche à ce que nous avons de plus intime, de plus central. » Pour alléger ce fardeau symbolique, certains préfèrent parler de « troubles schizophréniques » ou de « troubles hallucinatoires », des formulations plus descriptives, moins stigmatisantes.
Au-delà du vocabulaire médical ou médiatique, il existe un langage discret, spontané, inventé par les personnes concernées elles-mêmes. Mariette Darrigrand se souvient d’une jeune femme qui vivait des hallucinations : « Elle disait qu’elle avait des bugs dans son cerveau. Ce mot la soulageait. Un bug, ça arrive, ça se corrige, ça ne dit rien de votre valeur ni de votre avenir. Si on lui avait dit “vous êtes schizophrène”, elle l’aurait vécu comme une sentence. »
Ces mots ne sont pas scientifiques, mais ils ont une puissance réconfortante, ils décrivent sans condamner, appartiennent à la personne et n’enferment pas. Nous avions d’ailleurs exploré cette question dans Plein Espoir, à travers l’article consacré à la déclaration de Nicolas Demorand : Je suis malade mental.
Un travail lexical important à mener
Un autre mot occupe une place étrange : « psy ». On dit aujourd’hui qu’on va « voir son psy » comme on irait chez le coiffeur, mais dès qu’on précise « psychiatre », quelque chose se crispe.
Et c’est normal : le mot garde en lui des images d’autorité, de contrôle, de blouses blanches. Il hérite d’une psychiatrie ancienne où des médecins comme Charcot faisaient des démonstrations publiques pour montrer des crises d’hystérie, et ces scènes ont marqué durablement l’imaginaire. S’y ajoutent les photos d’époque montrant des patients attachés, ou les films où le psychiatre est mis en scène comme un gardien de l’ordre. Dans Vol au-dessus d’un nid de coucou, Shutter Island, One Flew Over the Cuckoo’s Nest ou même certaines scènes de Grey’s Anatomy, le « psychiatre » est celui qui maîtrise, discipline et décide d’enfermer. Rien à voir avec ce que signifie pourtant ce mot : en grec, « médecin de l’âme ».
Le terme “psy”, lui, s’est dilué avec le temps, c’est aussi parce qu’il recouvre aujourd’hui des réalités très différentes. Un psy peut être psychologue, psychothérapeute, psychanalyste ou neuropsychologue. Et ceux qui consultent n’ont pas tous les mêmes besoins. Un même diagnostic peut rassembler des vécus qui n’ont rien en commun, des intensités et des histoires très éloignées. Rien à voir avec les représentations simplifiées des séries.
C’est pour cela qu’il devient urgent de redonner de la précision à la langue, de sortir du fourre-tout. Peut-être faut-il, comme le suggère Mariette Darrigrand, repenser nos mots, affiner nos disciplines, inventer des appellations plus justes. Après tout, on consulte déjà un addictologue, un pédopsychiatre, un spécialiste des troubles du sommeil. Pourquoi ne pas aller voir un spécialiste du trouble bipolaire, un expert des psychotraumatismes ou des troubles dissociatifs, un accompagnant en santé mentale, plutôt qu’un « psy » ? Nommer avec justesse, ce n’est pas techniciser la relation. C’est commencer à écouter ce que vit réellement la personne concernée. Et c’est, peut-être, la première étape pour sortir enfin d’un héritage non choisi.
Pour repenser le langage, on peut aussi s’inspirer d’autres mouvements. Le féminisme, avec l’écriture inclusive, a montré qu’on pouvait créer de nouvelles formes pour corriger un manque de représentativité. Le collectif Bye Bye Binary va plus loin encore avec une typographie inclusive, preuve qu’il est possible d’inventer un alphabet différent lorsque l’existant exclut. Les communautés du handicap ou de la neurodiversité ont, elles aussi, créé leurs propres mots — “neuroatypique”, “neurodivergent”, “crip”, “survivant·e”, “spoonie”. Autant de termes qui ouvrent de nouvelles manières de se raconter.
Ces solutions rappellent une chose simple : quand un vocabulaire blesse ou limite, les communautés retournent ou inventent leurs propres mots.
Le rétablissement, quand les mots aident à changer le regard sur la santé mentale
Le courant du rétablissement occupe une place particulière dans la manière de repenser la santé mentale. Il permet de parler de ce qu’on voit rarement : les ajustements discrets, les journées où l’on progresse sans s’en rendre compte, celles où l’on doit ralentir. Le rétablissement reconnaît que ces variations existent, qu’un pas en arrière n’annule pas ceux d’avant. Il propose une manière plus fidèle de décrire la réalité des personnes concernées, sans simplifier leur parcours ni le réduire à une rupture. « Il ne s’agit pas de nier la blessure : c’est reconnaître qu’elle existe, mais refuser qu’elle définisse tout », rappelle Mariette Darrigrand.
Si le rétablissement permet de changer les mots, il reste à transformer les images qui leur sont associées. Car la stigmatisation ne se transmet pas seulement par le langage : elle circule aussi dans les récits, les films, les séries, dans tout ce qui façonne notre imaginaire collectif. Or, une nouvelle génération de fictions propose désormais un regard plus juste. BoJack Horseman explore les addictions avec nuance, Sex Education aborde les parcours de soin avec simplicité, et la série Empathie place l’écoute et la complexité des liens au centre du récit.
Ces œuvres ont un point commun : elles proposent des parcours de vie orientés solutions, où l’accompagnement, la parole, les proches et la vulnérabilité deviennent de véritables ressources. Elles déplacent doucement l’imaginaire collectif, non pas en niant la souffrance, mais en lui donnant plus de complexité, plus proche du réel, et donc plus proche de nous.
Ces récits peuvent devenir de nouveaux symboles. Des points d’appui pour penser différemment, pour imaginer une santé mentale représentée sans peur, sans caricature, avec plus de nuance.
Alors oui, il reste du travail pour alléger le poids symbolique des mots de la santé mentale, pour qu’ils collent davantage aux réalités vécues. Mais c’est un champ vivant, qui change à mesure que les personnes concernées prennent la parole et que les pratiques évoluent. C’est peut-être là sa vraie force : chercher encore à nommer sans réduire, à accompagner sans éloigner, à soigner sans effacer ce qui fait l’humain.