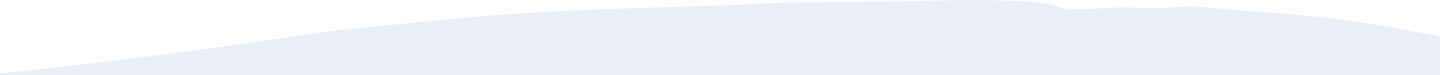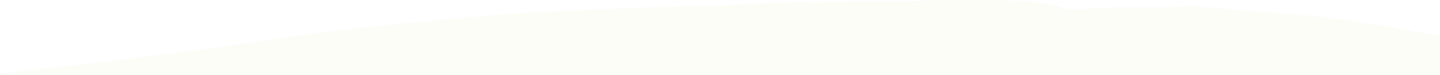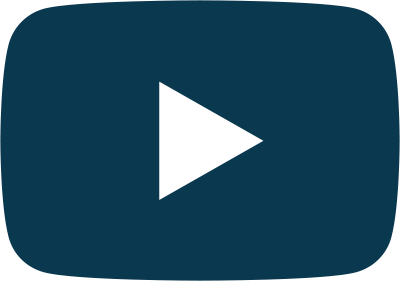Parler de mon trouble psychique m’a ouvert une nouvelle voie professionnelle
Choisir de parler de son trouble psychique, c’est une décision intime. Mais parfois, ce choix échappe, lorsque la maladie se manifeste brutalement. C’est ce qui est arrivé à Yannick Vialle, après une décompensation sur son lieu de travail. Lui qui redoutait d’être jugé ou mis à l’écart a finalement découvert une autre réalité : en acceptant d’en parler, il a trouvé du soutien et de nouvelles ressources. Pour Plein Espoir, il raconte comment ce dévoilement imposé l’a conduit à repenser sa trajectoire professionnelle et à se réinventer.
En octobre 2016, quand je suis embauché comme consultant en informatique dans une entreprise de solutions digitales juste après mes études, je ne me pose pas du tout la question du dévoilement, parce que je ne sais pas encore que je suis bipolaire. Avec du recul, je me rends compte que j’ai déjà connu des phases, mais à ce moment-là, tout ça me paraît encore très loin.
Dès mon arrivée, ce n’est pas simple. On me dit qu’il faut que je travaille la semaine à Toulouse, alors que je vis à Paris. C’est la première fois de ma vie que je prends l’avion, c’est dire. Mais comme je suis en période d’essai, je garde tout pour moi. Je suis partagé entre l’excitation de cette nouvelle expérience et le sentiment d’être un peu perdu. L’équipe n’est pas vraiment bienveillante, et pour réussir à suivre le rythme, je me mets à mélanger café et Red Bull, ce qui me rend hyperactif. Heureusement, je croise un manager d’une autre équipe qui décide de me prendre sous son aile et me propose de rejoindre son projet. Quelques semaines plus tard, ma période d’essai est prolongée. C’est une nouvelle compliquée à encaisser pour l’estime de soi. Et puis, je dois en parler à mes parents, trouver les bons mots pour expliquer la situation. Je ne le sais pas encore, mais je commence à entrer dans une phase de dépression. Je sens que je ne vais pas bien, mais chaque matin je continue de me lever pour aller travailler, je n’ai pas vraiment le choix.
« Un manque de considération humaine au travail »
Mon manager me fait un retour positif sur mon travail et je suis gardé. On me bascule sur un autre projet, où je suis censé gérer la partie technique, mais dans les faits, personne ne m’écoute et mes propositions ne sont pas prises en compte. En parallèle, ma vie personnelle se complique : je me sépare de ma copine, avec qui j’étais depuis quatre ans. Et là, je change de comportement. Moi qui d’habitude gardais les choses pour moi, je me mets à dire tout ce que je pense, que ce soit au travail ou dans ma vie personnelle. Bien sûr, sans vraiment mettre les formes. Juste pour donner un exemple : la veille de mon départ en vacances, je vois qu’un stagiaire ne prend même pas de pause-déjeuner parce qu’il est débordé. Je vais aussitôt en parler au responsable des stagiaires, qui me conseille d’aller voir la RH, ce que je fais tout de suite.
Quand j’entre dans son bureau, je commence par lui parler du stagiaire, puis de mes propres frustrations. Et là, je ne m’arrête plus. Je me lance dans une logorrhée, tout est un peu confus, mais elle m’écoute sans me juger. Ça compte beaucoup pour moi. Je ne me souviens pas de tout ce que j’ai dit ce jour-là, mais je sais que je lui ai expliqué, par exemple, que j’avais du mal à rester assis devant mon ordinateur, que je travaillais la nuit jusqu’à trois heures du matin parce que je ne supportais plus la pression ni le manque de considération humaine. Le soir même, j’envoie un mail à tous les salariés qui travaillent sur le projet, en mettant en copie cachée les personnes influentes de l’entreprise. Dans ce message, j’explique comment, selon moi, on aurait dû faire les choses pour que ça marche mieux.
« Je me sens tout puissant »
Je pars à Rome avec mon ex-compagne, parce que le séjour était déjà payé. Vu le contexte, ça ne se passe pas bien. Je dépense énormément d’argent, je me sens tout puissant, comme si rien ne pouvait m’arrêter. Quand on rentre, je vide mes affaires de son appartement en quelques heures. Je lance des cartons dans le couloir. C’est très compliqué de trier quatre ans de sa vie en si peu de temps. Après ça, je rejoins mes parents en Savoie, avec qui je dois participer à un concert. Dans le coffre, j’ai pris toutes mes affaires, mon piano et mon ordinateur. J’ai aussi loué un chalet à 2 000 euros la semaine, ce qui ne me ressemble pas.
Le lendemain, j’appelle un ami pour lui parler de mon nouveau projet : Dream your life and your life will be a dream. L’idée, c’est de créer un réseau social qui permettrait aux personnes qui partagent le même rêve de se connecter et de s’entraider pour le réaliser. Puis je repense à une collègue avec qui je m’étais disputé, qui est à Reims, et je décide d’aller la voir pour qu’on s’explique. À quatre heures du matin, je prends la route. Je roule à plus de 170 km/h sur l’autoroute et je perds quatre points sur mon permis. En arrivant, comme je n’ai pas son adresse, je sonne à n’importe quel interphone. Les personnes âgées qui me répondent n’ont sans doute pas compris.
Je me repose une heure puis je repars en Savoie. Au chalet, on me reproche de faire trop de bruit, de déranger. À la répétition du concert, c’est la même chose. À ce moment-là, ma sœur m’appelle pour me dire que si je ne me soigne pas, elle ne va pas me lâcher. Cette phrase m’a beaucoup marqué. Et c’est là que me reviennent en tête les informations sur Sainte-Anne que ma collègue de Reims, qui est une ancienne infirmière en psychiatrie, m’avait donné quand on parlait de TDAH. J’appelle au standard et on me dit que si je le souhaite, je peux me rendre aux urgences. Mes parents m’accompagnent, mais je veux absolument conduire. C’est seulement quand un camion se met devant moi que je comprends qu’il faut que j’arrête de rouler à 170 km/h sur l’autoroute, ce qui soulage mes parents.
« Qu’il soit visible ou invisible, le handicap est trop stigmatisé »
À une heure du matin, j’arrive à Sainte-Anne avec l’étrange impression d’être attendu. On me fait remplir un petit formulaire, je vois une infirmière, puis une psychiatre. Je lui parle de mon idée de réseau social et je lui dis que je suis plus fort que Steve Jobs, parce que moi je n’ai pas besoin d’argent : ce qui me rend heureux, c’est de donner du bonheur aux autres. Elle m’écoute, puis à un moment elle me demande : « Est-ce que vous êtes prêt à vous faire soigner ? » J’accepte. On m’installe dans un box et mon père signe une demande de tiers. Le lendemain, j’apprends que je suis dans une unité fermée. J’y reste deux semaines. C’est la première fois qu’on me parle de bipolarité. Je ne me souviens pas très bien de comment je vis l’annonce ni de cette période. Tant que je ne comprends pas ce que ça veut dire, ça ne me fait pas grand-chose.
Quand je reviens au bureau après mon hospitalisation, je repense au mail que j’ai envoyé le jour de mon départ en vacances, et je suis persuadé que tout le monde est au courant. J’ai peur qu’on me regarde de travers, d’être mis de côté. Je vois la médecine du travail, et on me parle de la RQTH (reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé). Le mot handicapé ne me va pas. Pour moi, c’est de la stigmatisation. Ça renforce l’idée que c’est lié au handicap. Et en France, qu’il soit visible ou invisible, le handicap reste encore stigmatisé. D’ailleurs, puisqu’on parle de mots, moi je préfère l’ancien nom de mon trouble : la psychose maniaco-dépressive. Parce que quand je dis à quelqu’un que je suis bipolaire, souvent la réaction c’est : ah, donc un jour tu dis oui, un autre jour tu dis non. J’aime pas du tout l’effet que ça produit chez les gens.
Le soir de mon retour, quand je suis convoqué dans le bureau d’un manager, je me demande si c’est à cause de ça. Mais non : il veut juste que je rejoigne son équipe, ce que j’accepte. Pendant deux ans, je prends mes médicaments et je suis suivi par un psychiatre au CMP (centre médico-psychologique). À ce moment-là, j’estime que je suis aussi efficace que n’importe qui. Il n’est pas encore question de dévoilement, parce que je n’ai pas vraiment conscientisé ce qu’il se passe.
« Je me sens écouté et c’est un moment important »
Deux ans plus tard, en février 2020, je fais une décompensation chez un client. Pour la première fois de ma vie, je me dis que je ne suis pas capable de retourner au bureau le lendemain. Même pour récupérer mes affaires, c’est impossible. Dès le lendemain, je suis arrêté pendant deux mois. Quand je reviens, la RH, celle avec qui j’ai parlé en 2017, me propose un rendez-vous avec mon responsable et le chef d’équipe. Cette fois, c’est elle qui me parle de la RQTH. Elle me dit qu’elle est prête à m’aider et qu’elle veut que tout se passe bien pour moi dans l’entreprise. J’accepte la main tendue. Au fond, c’est mon premier pas dans le dévoilement. Je ne l’ai pas prévu, mais comme je me sens écouté, c’est un moment important dans mon parcours de rétablissement.
À partir de 2021, je commence à en parler à mes collègues, parce que je ne veux pas me mettre en danger au travail. Tout le monde n’est pas forcément prêt à entendre certaines choses, mais ça se passe mieux que je l’imagine. Un manager me dit même qu’il s’en fiche, que je suis comme je suis. Il ne porte ni jugement positif ni négatif, pour lui c’est juste une part de moi, comme une autre. Désormais, je suis ma priorité. Selon les projets et les collègues avec lesquels je travaille, je tâte un peu le terrain pour voir comment ça peut se passer, mais je n’ai plus peur d’en parler.
Je lance un projet de financement participatif avec la Maison Perchée, une association qui accompagne les jeunes adultes vivant avec un trouble psychique et leurs proches. Je les aide à créer des plaquettes pour leur site et pour les impressions. On a deux mois pour récolter la somme, mais en deux semaines c’est déjà bouclé. J’envoie le lien à mes collègues et je leur demande de relayer. Ça me permet de commencer la sensibilisation autour de moi. Après cette expérience, je fais un bilan de compétences et je me rends compte que l’informatique, ce n’est finalement pas fait pour moi (rires). Je me forme pour être formateur aux premiers secours en santé mentale (PSSM), puis pour devenir médiateur en entreprise. Je deviens aussi animateur de la fresque pour parler de la santé mentale au travail, le même principe que la fresque du climat, pour parler de ces sujets au travail.
« Mon dévoilement m’a aidé à me trouver professionnellement »
Aujourd’hui, je viens de quitter mon entreprise et de créer la mienne : Ympath’Q. Le nom a plusieurs sens. Il y a d’abord le mot impact, parce que je veux avoir un impact positif. Le Y c’est un clin-d’œil à mon prénom, mais aussi l’initiale de You (toi), pour montrer que tout le monde est concerné. Le path représente le chemin, qui peut être plus ou moins long. Et enfin, le Q, pour quotient, symbolise ce qu’on apprend et ce qu’on transmet. L’idée derrière ce nom, c’est qu’avec le savoir expérientiel, le chemin mène toujours vers l’acceptation. Et je continue à avancer. En ce moment, je suis une formation de facilitateur de l’intelligence collective à Lyon, pour apprendre à mieux valoriser l’humain dans l’entreprise.
Mon parcours en entreprise a beaucoup compté dans ma construction, mais j’en ai aussi vu les limites. Aujourd’hui, la question que je me pose est simple : comment vraiment inclure la personne dans toutes ses dimensions au travail ? Pour moi, il est essentiel que les organisations s’intéressent à l’intelligence émotionnelle, c’est-à-dire la capacité à reconnaître, comprendre et exprimer ce qu’on ressent, mais aussi à accueillir les émotions des autres. Je suis persuadé que si les personnes s’autorisent à parler de leurs émotions, ça peut éviter bien des choses : des décompensations, des burn-out, de l’anxiété et tous les autres maux qui rongent le monde du travail.
Je trouve qu’on n’écoute pas assez les autres. On ne demande pas vraiment comment vont les gens autour de nous. Souvent, on se contente d’un « oui » de politesse, tout en cachant ce qu’on ressent vraiment. Malheureusement, tout le monde en souffre. On a le droit de dire qu’on ne va pas bien. Dans mon parcours, j’ai eu la chance de pouvoir parler, d’être entendu sans être dévalorisé, et j’ai envie de porter cet espoir-là. Mais dans beaucoup d’endroits, cette possibilité n’existe pas, parce que la priorité reste la rentabilité, la performance, et tout ce qui va avec.
Finalement, mon dévoilement m’a ouvert une nouvelle voie, celle de mon avenir professionnel, ce que je n’aurais jamais imaginée. Le fait d’en parler m’a permis d’explorer un champ des possibles, de créer des opportunités, mais aussi de me protéger. J’ai pris conscience que l’expression des émotions dans le monde du travail est essentielle. C’est pourquoi, avec mon entreprise, je veux faciliter cette expression pour aider les organisations à devenir plus émotionnellement intelligentes.
Vous souhaitez en savoir plus et rencontrer d’autres personnes engagées dans le rétablissement ? Rejoignez les réseaux sociaux de Plein Espoir, le média participatif dédié au rétablissement, créé par et pour les personnes vivant avec un trouble psychique.
Cet espace inclusif est une initiative collaborative ouverte à toutes et tous : personnes concernées, proches, et professionnels de l’accompagnement. Vos idées, témoignages, et propositions sont les bienvenus pour enrichir cette aventure. Contribuons ensemble à bâtir une société plus éclairée et inclusive.